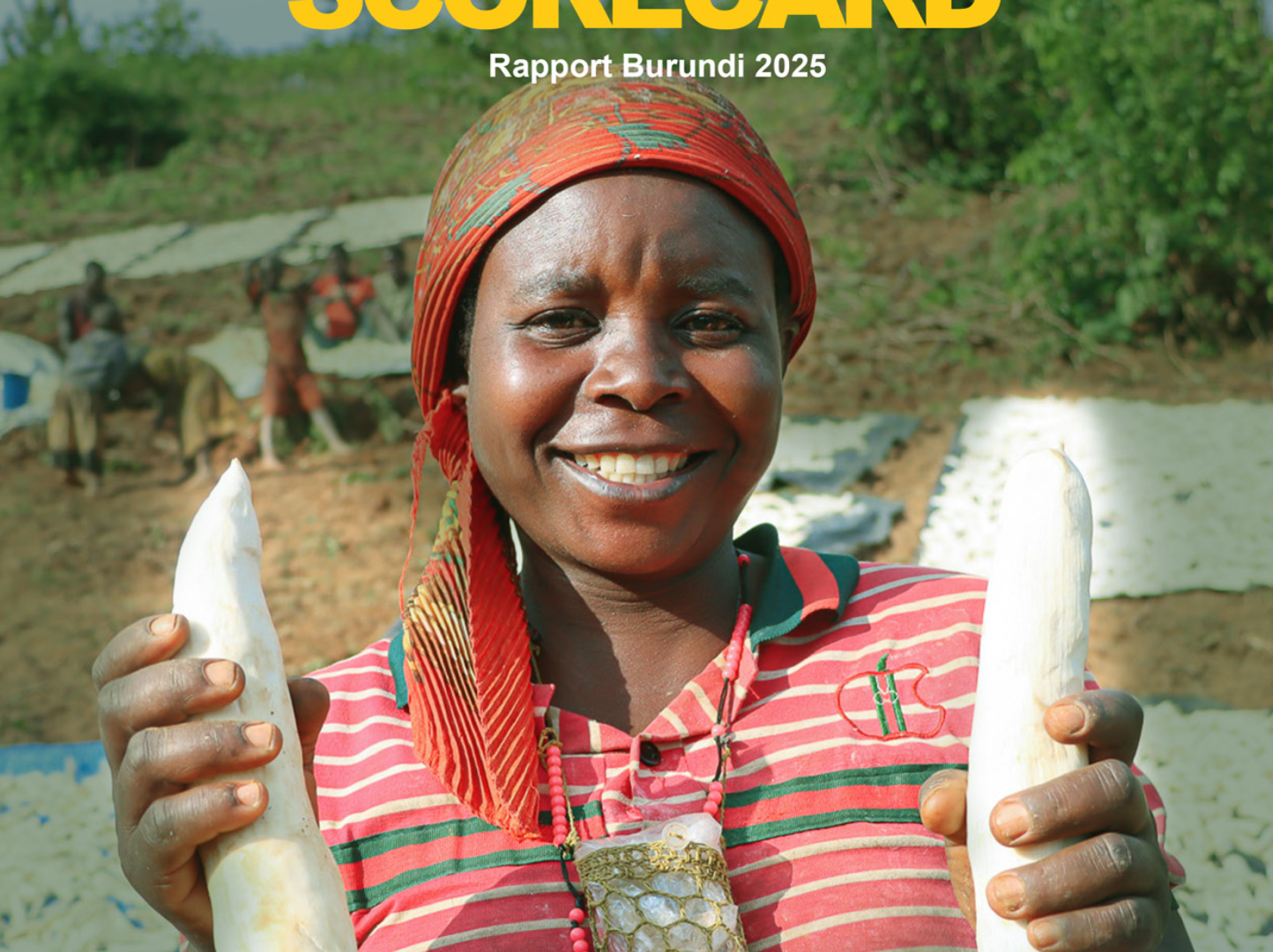Dernières actualités
Histoire
31 décembre 2025
Investir dans l’enfance : les Femmes Leaders tracent la voie lors de la 6ᵉ édition du Forum
Pour en savoir plus
Histoire
11 décembre 2025
Le Burundi fait face à un afflux massif alors que le conflit s’intensifie dans l’Est de la RDC
Pour en savoir plus
Histoire
28 novembre 2025
Clôture du projet SEPAREF : des résultats satisfaisants de sa mise en œuvre
Pour en savoir plus
Dernières actualités
Les objectifs de développement durable au Burundi
Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Burundi:
Histoire
31 décembre 2025
Investir dans l’enfance : les Femmes Leaders tracent la voie lors de la 6ᵉ édition du Forum
La 6ᵉ édition du Forum de Haut Niveau des Femmes Leaders s’est tenue les 20 et 21 novembre 2025, réunissant dirigeantes, experts, représentants des organisations nationales et internationales, ainsi que des partenaires engagés pour le bien-être des enfants au Burundi. L’édition de cette année a mis un accent particulier sur un thème crucial : « Soins attentifs de l’enfance à la puberté pour un développement harmonieux ».Un panel d’experts tourné vers des solutions pratiquesLe 21 novembre, un panel d’experts de haut niveau a captivé l’attention des participantes et participants en présentant des stratégies concrètes et innovantes pour améliorer les soins attentifs prodigués aux enfants.Ils ont souligné qu’investir dans l’enfance n’est pas seulement une responsabilité sociale, mais également l’une des décisions les plus rentables pour l’avenir d’un pays : meilleure santé, meilleures capacités d’apprentissage, plus grande résilience et cohésion sociale renforcée.Les discussions ont couvert plusieurs aspects essentiels : la nutrition et la santé de la petite enfance, la protection contre les violences, discriminations et négligences, l’accès équitable à l’éducation et à l’information, le rôle des familles, des communautés et des institutions, l’importance d’une approche multisectorielle fondée sur la science, la prévention et l’empathie.L’intervention de M. Adama Moussa : un plaidoyer fort pour l'investissement dans l'enfanceParmi les intervenants majeurs, M. Adama Moussa, Directeur Régional Adjoint de l’ONU Femmes au Bureau Régional d’Afrique de l’Est et Australe, a livré un message particulièrement inspirant. Il a rappelé que, dans une région où la majorité de la population est jeune, investir dans des soins attentifs est une nécessité stratégique, à la fois pour le développement humain et pour l'avenir des communautés.Selon lui, chaque action posée aujourd’hui pour protéger, soutenir et accompagner l’enfant contribue à la construction d’une société plus prospère, plus égalitaire et plus résiliente. Il a également salué les initiatives de la Première Dame du Burundi pour placer l’enfance et l’adolescence au cœur des priorités nationales.Des échanges qui enrichissent la compréhension collectiveLes contributions des intervenants ont considérablement renforcé la compréhension : des enjeux contemporains liés au développement de l’enfant, des défis auxquels font face les familles et les communautés, des meilleures pratiques à adopter pour offrir un environnement protecteur, stimulant et bienveillant.Cet espace d’échange, à la fois riche et constructif, a permis de partager des expériences nationales, des données actualisées et des perspectives internationales. Il a aussi inspiré de nouvelles pistes pour renforcer les politiques publiques ainsi que les initiatives communautaires.Vers un avenir meilleur pour les enfants du BurundiLa 6ᵉ édition du Forum a rappelé que préparer un avenir meilleur pour les enfants nécessite un engagement collectif : les décideurs politiques, les familles, les organisations de la société civile, les institutions éducatives, les partenaires techniques et financiers, ainsi que chaque membre de la communauté.L’événement s’est clôturé sur une note d’espoir, avec un consensus clair : les soins attentifs constituent l’un des fondements les plus puissants pour bâtir une société inclusive et prospère.
1 / 5

Histoire
11 décembre 2025
Le Burundi fait face à un afflux massif alors que le conflit s’intensifie dans l’Est de la RDC
Au cours des cinq derniers jours, des dizaines de milliers de civils en provenance de l’est de la République Démocratique du Congo (RDC) ont franchi la frontière burundaise pour fuir les violents affrontements en cours au Sud-Kivu. Des familles entières sont arrivées épuisées après avoir marché plusieurs jours depuis Kamanyola, Luvungi, Katogota et Sange, beaucoup ayant passé des nuits dans la brousse sans nourriture ni abri. La plupart ont atteint la frontière sans aucun bien, ayant tout abandonné dans leur fuite. Au site d’accueil de Ndava, dans l’ancienne province de Cibitoke, Déborah Batacoka, 60 ans, raconte son calvaire. « Nous avons marché pendant trois jours et dormi dans la brousse. Les villages sont désormais vides. Nous avons tout laissé derrière nous. Nous avons faim et les enfants s’évanouissent d’épuisement », dit-elle en désignant des enfants allongés, faibles, sur le sol.Léa Usa, enceinte de six mois, décrit la terreur qu’ils ont fuie : « Des bombes sont tombées sur notre village à Luvungi. Nous entendions des balles partout et avons vu des voisins déchiquetés par les explosions. Le village est complètement désert maintenant », confie-t-elle.Le centre de transit de Cishemere — premier point d’accueil — a rapidement été saturé, hébergeant plus de 4 000 personnes. Les autorités et les partenaires humanitaires ont dû rediriger les nouveaux arrivants vers le site de Ndava. De là, les personnes déplacées sont progressivement relocalisées vers le site nouvellement désigné de Bweru, dans la province de Buhumuza, actuellement en cours d’aménagement pour offrir une assistance plus adéquate. « Nous travaillons en étroite collaboration avec le Gouvernement du Burundi, les partenaires humanitaires et les donateurs pour mobiliser une aide urgente », a déclaré Brigitte Mukanga-ENO, Représentante du HCR au Burundi. « Nourriture, médicaments, eau et abris d’urgence sont essentiels pour éviter que cette situation déjà alarmante ne se transforme en crise humanitaire majeure. »La majorité des arrivants sont des femmes enceintes, des personnes âgées et des enfants non accompagnés, séparés de leurs familles dans le chaos. Bahati Antoinette, 30 ans, est sans nouvelles de ses cinq enfants depuis que les combats ont atteint Luberizi il y a trois jours. « Je suis extrêmement inquiète », dit-elle. À Kaburantwa, Nabuye Christine, 70 ans, recherche son mari disparu, portant ses derniers effets personnels. Plus de 33 000 personnes déplacées ont franchi la frontière burundaise en seulement cinq jours, s’ajoutant aux 110 000 réfugiés déjà accueillis dans cinq camps et un site. Les besoins humanitaires continuent d’augmenter fortement à mesure que le conflit au Sud-Kivu s’intensifie.
1 / 5

Histoire
28 novembre 2025
Clôture du projet SEPAREF : des résultats satisfaisants de sa mise en œuvre
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage (MINEAGRIE) et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont organisé le 19 novembre 2025 l’atelier d’achèvement du projet « Multinational : renforcement de l'état de préparation et de la réponse d'urgence à la crise alimentaire au Burundi, aux Comores, en Somalie et au Soudan du Sud (SEPAREF). Cette intervention financée sur un don de la BAD au Gouvernement du Burundi a été mise en œuvre par la FAO sous la supervision du MINEAGRIE. Lancé en mai 2023, ce projet visait l'amélioration de la production agricole, la productivité et la résilience des systèmes de production agricole dans le pays, pour atténuer les risques à court et à long terme aggravés par la guerre en Ukraine. Les parties prenantes saluent ses résultats concrets.Financé par la BAD à hauteur de 2 574 000 dollars, le projet SEPAREF a été mis en œuvre dans les anciennes provinces de Cibitoke, Gitega, Kayanza, Mwaro et Rutana. Le projet était articulé sur trois composantes : l’augmentation de la production de semences de première génération, l’intégration de plateformes numériques d’alerte précoce et le renforcement institutionnel.Des résultats positifs dans plusieurs domainesLe délégué du Représentant de la FAO à l’atelier, M. Umberto Ciniglio, a souligné les performances techniques du programme, expliquant qu’à l’approche de sa clôture définitive – fin décembre 2025 -, SEPAREF enregistre un taux de décaissement de 100 pour cent et une performance technique de 98 pour cent. En effet, le projet a permis d’appuyer 13 752 ménages et a produit des résultats tangibles dans plusieurs domaines, notamment en matière de production de semences de première génération. Il a également renforcé les capacités des institutions nationales, notamment l’Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU), l’Office National de Contrôle et de Certification des Semences (ONCCS), les Bureaux Provinciaux de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage (BPEAE), la Direction de la Promotion des Filières Agricoles et des Produits Forestiers Non Ligneux sans oublier les organisations des producteurs (OP) ainsi que des privés multiplicateurs de semences. Aussi, le projet a appuyé l’ISABU dans le renforcement des capacités de production des semences de prébase en termes de multiplication des semences de haricot, blé, soja et maïs hybrides trois voies. Les infrastructures agricoles ont également bénéficié du projet, notamment par la réhabilitation du périmètre irrigué de Rujembo pour la production de semences en toutes saisons et la construction de 4 aires de séchage avec abris. De nouvelles variétés élites de soja et de blé ont été introduites.De plus, SEPAREF a organisé des foires à semences destinées aux bénéficiaires vulnérables afin de diffuser à grande échelle des semences de qualité. Le développement d’une Plateforme Nationale de Gestion des Semences au Burundi constitue également un acquis majeur qui permettra aux principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement en semences, notamment les organismes de réglementation des semences, les entreprises et les producteurs de semences, etc., d'être intégrés sur une plateforme unique numérisant la coordination des semences, l'information sur le marché des semences et le contrôle de la qualité.L’organisation régulière d’ateliers de formation et d’analyses IPC après chaque saison agricole a permis un suivi rigoureux de la tendance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet a également appuyé la formulation du Projet de Développement Intégré Burundi-Rwanda (BRIDEP).Umberto Ciniglio a indiqué que « les activités du SEPAREF ont essentiellement contribué à l'amélioration de la production et des conditions de vie à travers l'augmentation des revenus issus de la vente des surplus. L'amélioration de l'environnement a également été mise en avant par la mise en place de dispositifs antiérosifs sur les parcelles de multiplication ainsi que la promotion de la lutte intégrée et l'utilisation des extraits végétaux et de biopesticides ».La BAD satisfaiteDe son côté, Pascal Yembiline, Responsable Pays du Groupe de la Banque Africaine de Développement au Burundi, a exprimé sa satisfaction face aux résultats obtenus. « Pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction. Le projet a atteint à 100 pour cent ses objectifs. Il les a même dépassés dans certains domaines », a-t-il déclaré, avant d’assurer que la BAD reste engagée dans le domaine agricole. Il a rappelé que « la stratégie de la BAD pour la période 2024-2029 fait du développement agricole un axe majeur. En fait, c'est le premier axe d'intervention de la BAD ». Il a salué la collaboration exemplaire entre la BAD, le gouvernement burundais et la FAO, affirmant qu’« il s'agit d’un modèle de coordination à suivre et à élargir aux opérations à venir ». Les participants ont également visité les stands d’exposition présentant des échantillons de semences produites, notamment quelques variétés de maïs, de blé, de soja et des haricots. Les multiplicateurs de semences ont livré des témoignages émouvants. Concilie Igirukwishaka, de l’ancienne commune de Makebuko, a notifié qu’elle avait bénéficié d’un important appui de la FAO. Elle a reçu des semences sélectionnées et des fertilisants qui lui ont permis de cultiver huit hectares en appliquant de nouvelles techniques apprises lors des formations. Elle a confié qu’elle avait pu produire et vendre des semences lors des foires organisées au mois de février 2025 et obtenir d’un coup 20 millions de francs burundais, tout en gagnant une clientèle fidèle grâce à la qualité de ses semences.Gasunzu Evariste, de l’ancienne commune de Giheta, a également témoigné. Il a expliqué avoir multiplié des semences de haricots et de maïs grâce aux intrants reçus du projet. Il a affirmé que les deux années d’appui du SEPAREF portant sur quatre saisons agricoles lui ont permis d’améliorer considérablement ses revenus, au point de couvrir aisément les frais scolaires de ses enfants. Son expérience a même inspiré les autres membres de sa coopérative qui ont réussi à multiplier à leur tour des semences de qualité.L’atelier a été également l’occasion d’effectuer une démonstration des fonctionnalités de la Plateforme Nationale de Gestion des Semences, un outil destiné à moderniser l’accès aux semences et à renforcer la traçabilité des stocks dans tout le pays.Samson Musonerimana, Directeur général de l’ISABU, qui a représenté le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage à l’atelier, a reconnu les effets positifs de SEPAREF, « nous sommes satisfaits de ce que le projet a réalisé. C’est un projet pilote qui a obtenu des résultats très satisfaisants et qui pourrait servir de modèle aux autres projets et programmes », a-t-il déclaré.Les acquis du SEPAREF vont être mis à l’échelle par le projet BRIDEP qui est également financé par la BAD et qui est mis en œuvre au Burundi et au Rwanda.
1 / 5

Histoire
27 novembre 2025
De l’urgence à la résilience : amélioration des conditions de vie des bénéficiaires de deux projets CERF axés sur la sécurité alimentaire et l’adaptation climatique
Du 26 au 27 novembre 2025, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en collaboration avec le Gouvernement du Burundi a organisé un atelier de clôture et capitalisation des bonnes pratiques de deux projets d'urgence financés par OCHA via le fonds CERF « Central Emegency Response Fund » et mis en œuvre par la FAO au courant de l’année 2025 dans les anciennes provinces de Bujumbura, Cibitoke et Rumonge. Il s'agissait du projet « Appui au renforcement de la résilience communautaire face aux chocs climatiques par la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature » et du projet « Réponse aux besoins urgents et persistants en matière de sécurité alimentaire ». A son actif, le projet sur la sécurité alimentaire a appuyé 3 000 ménages vulnérables déplacés, retournés et familles d’accueil en leur fournissant une aide d'urgence pour répondre à leurs besoins alimentaires et nutritionnels essentiels, notamment par la distribution de kits agricoles (engrais, semences et outils) et de kits d’élevage (lapins, aliments et produits vétérinaires), qui ont contribué à la protection et restauration des moyens de subsistance de ces ménages vulnérables.Quant au projet de résilience climatique qui visait à répondre aux besoins humanitaires urgentstout en renforçant la résilience climatique, il a appuyé plus de 7 000 ménages vulnérables affectés par des phénomènes météorologiques extrêmes (inondations, sécheresses, glissements de terrain). Il a également restauré des paysages naturels dégradés et stabilisé des zones à risque par le reboisement, le traçage et la végétalisation des courbes de niveau, accompagné par des renforcements de capacité sur les pratiques agricoles et agroforestières durables et adaptées au climat, à l’échelle des exploitations et des bassins versants. Des résultats admirablesLe projet de sécurité alimentaire a permis aux ménages assistés à améliorer leur score alimentaire passant d’un seul repas par jour à deux repas par jour même à trois repas par jour pour certains. Ainsi, le projet a amélioré la sécurité alimentaire et l’état nutritionnelle des ménages appuyés. Quant au projet de résilience climatique, les résultats sur terrain ont presque doublé par rapport aux prévisions. Plus de 6 200 000 plants ont été produits et plantés dans les espaces communautaires les plus dégradés alors que c’était prévu la production et plantation de de 3 500 000 plants seulement. En tout, près de 600 ha sur 187 ha attendus ont été protégés par les plants d’arbres produits et les courbes de niveaux tracés par les bénéficiaires du projet via l’approche « Cash for work ». Ces activités ont permis d’injecter plus de 460 000 USD dans la communauté, permettant aux ménages bénéficiaires de répondre à leurs besoins urgents et aussi de diversifier les sources de revenus de leurs ménages.Les prouesses de ces deux projets ont suscité l’admiration des parties prenantes. Dans son allocution lors de l’ouverture de l’atelier, le délégué du Représentant de la FAO, Umberto Ciniglio, a salué la pertinence des fonds CERF qui ont permis d’apporter une réponse rapide aux besoins urgents des bénéficiaires tout en renforçant la résilience climatique. « Nous sommes vraiment satisfaits des résultats atteints par les deux projets. D’une part, en visitant ne serait-ce que le site de Gateri, les résultats sont palpables ! Nous voyons les jardins et potagers familiaux qui sont dans les cours des personnes réinstallées. D’autre part, nous voyons aussi comment l'environnement a été récupéré si on peut ainsi dire et comment la plantation des arbres a fait changer la physionomie d'un site qui était au début vraiment nu, qui n'avait pas de végétation et qui commence vraiment à prendre l'aspect d'un village intégré avec des perspectives environnementales très satisfaisantes », a salué Mme Zinatou Boukary, Cheffe de bureau d’OCHA au Burundi et représentant du Bailleur.Mme Zinatou fait remarquer que les bénéficiaires des deux projets sont passés de la phase d’urgence à la résilience. Elle plaide pour la prise du relais par les partenaires au développement pour continuer sur le même élan. « Ils ont quitté la phase des personnes en besoin critique d'urgence pour entrer maintenant dans une phase de relèvement et il appartient aux bailleurs de développement de les accompagner à se relever de façon durable », a-t-elle souligné.Coté gouvernement, le délégué du Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage dans l’atelier a lui-même salué les résultats visibles et visitables sur terrain des deux projets. M. Clément Ndikumasabo a interpellé l’administration à la base, les différents services des différentes institutions de l'État et aussi les bénéficiaires de ces projets à entreprendre déjà des actions de nature à pérenniser les acquis des deux projets.
1 / 5

Histoire
20 novembre 2025
ONU Femmes participe à l’ouverture de la 6ᵉ édition du Forum de Haut Niveau des Femmes Leaders au Burundi
ONU Femmes Afrique, représenté par Adama Moussa, Directeur Régional Adjoint de, a pris part à l’ouverture officielle de la 6ᵉ édition du Forum de Haut Niveau des Femmes Leaders, organisé par le Bureau de la Première Dame du Burundi sous le Haut Patronage du Président de la République du 20 au 21 novembre 2025.Réunissant des dirigeantes, des organisations de la société civile, des partenaires au développement, des institutions publiques et des acteurs clés de la défense des droits des femmes, cette édition 2025 a mis en avant le thème : « Soins attentifs de l’enfance à la puberté pour un développement harmonieux ».Placer l’enfant au centre du développement nationalCette édition du Forum a rappelé que les premières années de vie déterminent non seulement la santé d’un enfant, mais aussi sa capacité à apprendre, à participer à la vie sociale et à contribuer à l’avenir du pays.Un accompagnement attentif, cohérent et de qualité — de la petite enfance à la puberté — constitue ainsi un levier essentiel pour bâtir une génération épanouie, résiliente et capable de jouer un rôle actif dans la transformation du Burundi.Les discussions ont mis en lumière les enjeux majeurs liés à : la santé et la nutrition, la protection de l’enfant, le développement psycho-affectif, l’accès à une éducation de qualité, les compétences nécessaires pour la vie et l’autonomie.ONU Femmes réaffirme son engagement aux côtés du BurundiEn participant à ce rendez-vous de haut niveau, ONU Femmes a renouvelé son engagement à travailler de concert avec la Première Dame, les institutions nationales et les partenaires techniques pour promouvoir la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles au Burundi. À travers ONU Femmes Burundi, l’organisation poursuit ses actions visant à renforcer l’égalité de genre, prévenir les violences, améliorer l’accès aux services essentiels et soutenir l’autonomisation des femmes et des adolescentes partout dans le pays.« Le meilleur investissement », selon les Nations UniesPour Violet Kakyomya, Coordonnatrice Résidente du Systèmes des Nations Unies au Burundi, l’investissement dans les soins attentifs constitue « le meilleur investissement » qu’un pays puisse réaliser, particulièrement dans un contexte comme celui du Burundi où plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. Elle a insisté sur la nécessité d’un engagement soutenu pour améliorer : la santé, la nutrition, la protection, et l’éducation des enfants. Ces investissements, a-t-elle rappelé, génèrent des retombées durables sur la stabilité, la productivité et le développement du pays.Un Forum pour bâtir une société plus inclusive et plus résilienteLa 6ᵉ édition du Forum de Haut Niveau des Femmes Leaders a réaffirmé la volonté du Burundi de construire un environnement où chaque enfant en particulier chaque fille peut grandir dans la dignité, en toute sécurité, avec l’opportunité de contribuer pleinement à la vie nationale.ONU Femmes réitère sa détermination à accompagner ces efforts et à soutenir des actions ambitieuses pour que les filles et les femmes du Burundi puissent réaliser leur potentiel et participer à un développement durable, équitable et inclusif.
1 / 5

Communiqué de presse
04 novembre 2025
Le Burundi accueille la 21ᵉ Réunion stratégique régionale sur les risques liés aux matières dangereuses chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (NRBC)
L’engagement du Burundi et de ses partenaires Du 4 au 6 novembre, le Gouvernement du Burundi a accueilli à Bujumbura la 21ᵉ Réunion stratégique régionale réunissant onze pays d’Afrique centrale et orientale. Cette rencontre visait à partager les expériences nationales sur la gestion des risques liés aux substances chimiques, aux maladies et aux matières radioactives, ainsi qu’à renforcer la coopération régionale dans ce domaine. L’événement a été organisé dans le cadre de l’Initiative des Centres d’Excellence de l’Union européenne pour l’atténuation des risques NRBC (EU CBRN CoE), à laquelle le Burundi a adhéré comme pays partenaire en 2013. Financée par l’Union européenne, depuis sa création en 2010 cette initiative soutient les pays partenaires dans le renforcement de la coordination, le renforcement des capacités et l’élaboration de politiques visant à réduire les risques liés aux matières dangereuses. Sa mise en œuvre est appuyée par l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI). Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Syldie MANIREREKANA, Assistant du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au Développement, a souligné l’engagement du Burundi à œuvrer pour une Afrique centrale et orientale plus sûre, plus résiliente et plus solidaire, capable de prévenir les crises liées aux matériaux dangereuses plutôt que de les subir. La Délégation de l’Union européenne au Burundi était représentée par Mme Laure DREGE, Cheffe de la coopération par intérim, qui a rappelé que la sécurité NRBC dans la région contribue directement à la sécurité et à la prospérité mondiale. Elle a insisté sur le caractère partenarial et collaboratif de l’appui de l’Union européenne, fondé sur le respect mutuel, l’apprentissage partagé et la recherche conjointe de solutions. Mme Clara ANYANGWE, Représentante résidente d’ONU Femmes, s’exprimant au nom de la Coordonnatrice résidente des Nations Unies pour le Burundi, a salué l’esprit de collaboration et de proactivité incarné par l’Initiative CBRN CoE de l’Union européenne face à la complexité croissante des menaces NRBC dans un monde en constante évolution. Elle a également indiqué que le Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable du Burundi comprend plusieurs points de convergence avec les priorités du NRBC.Les discussions lors de la réunion ont également porté sur l’impact des projets régionaux financés par l’Union européenne, qui visent notamment la gestion sûre des déchets chimiques, le renforcement de la biosécurité et de la sûreté biologique, la formation et la préparation des premiers intervenants, ainsi que la fourniture d’équipements techniques spécialisés aux pays partenaires. Les échanges interactifs ont permis d’identifier les priorités régionales, d’évaluer les défis rencontrés et de formuler des pistes de collaboration future. Un partenariat solide entre le Burundi, l’Union européenne et les Nations uniesEn amont de la réunion, le Gouvernement du Burundi a reçu le Bureau régional pour l’Afrique centrale et orientale de l’Initiative CBRN CoE de l’Union européenne, pour réaffirmer le partenariat de longue date entre le Burundi et l’Initiative. Le Secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au Développement, M. Ferdinand BASHIKAKO, a rencontré le Directeur du Bureau régional, M. James CHUMBA, et son équipe. M. Bashikako a mis en avant le défi majeur que les risques NRBC restent méconnus, qui peut exposer les populations à des dangers involontaires. La Protection civile en première ligne La Protection Civile du Burundi est le principal bénéficiaire des équipements techniques NRBC fournis par l’Union européenne. Deux de ses cadres suivent actuellement le programme de master en gestion NRBC développé grâce à l’Initiative CBRN CoE de l’UE, en partenariat avec des universités du Maroc et de la France. Le Général de Brigade de Police Célestin NIBONA BONANSIZE, Assistant du ministre de l’Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, a exprimé la gratitude du Gouvernement burundais pour les appuis fournis par l’Union européenne, qui contribuent au renforcement des capacités nationales face aux risques d’accidents et d’incidents impliquant des matières dangereuses. L’Initiative CBRN CoE de l’Union européenne œuvre à la création d’un monde plus sûr et plus résilient à travers la coopération avec 63 pays partenaires, dont 28 en Afrique, répartis dans huit régions du monde. Les réseaux régionaux d’experts jouent un rôle central dans la définition et la mise en œuvre de formations ciblées visant à renforcer la réduction des risques NRBC. Lancée en 2010, l’Initiative, mise en œuvre conjointement par la Commission européenne et l’UNICRI, vise à renforcer les capacités nationales pour prévenir, se préparer, répondre et se relever des incidents NRBC. Cette année marque le 15ᵉ anniversaire de l’Initiative CBRN CoE, témoignant de l’engagement commun de l’Union européenne, des Nations Unies et des pays partenaires à œuvrer ensemble pour rendre le monde plus sûr. Pour plus d’informations : https://cbrn-risk-mitigation.network.europa.eu
1 / 5
Communiqué de presse
01 novembre 2025
Remise d’un don aux réfugiés congolais au Burundi par le HCR et la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi
La cérémonie s’est déroulée en présence de Madame Brigitte Mukanga Eno, Représentante du HCR au Burundi, qui a salué cette initiative :« Cette assistance arrive à point nommé, alors que l’aide humanitaire destinée aux réfugiés, tant au niveau mondial qu’au Burundi, connaît une baisse significative. Elle permettra de compléter l’assistance alimentaire fournie par le PAM durant les deux prochains mois. » Le don remis aujourd’hui représente un premier lot de 472 tonnes de vivres, comprenant de la farine de maïs et de soja, des haricots, du riz, de l’huile, du sucre et du sel. Ce don a été financé par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et le Fonds National des Réparations des Victimes de Violences Sexuelles liées aux Conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (FONAREV). La distribution a été assurée par African Initiatives for Relief and Development (AIRD), partenaire du HCR au Burundi.Madame Katty Emilie Massoulis a exprimé l’engagement de la Fondation :« Nous avons été profondément interpellés par la situation de nos compatriotes déplacés par le conflit. C’est avec émotion et solidarité que nous apportons notre contribution pour les soutenir durant cette période difficile. » Ce don fait suite à une première assistance octroyée par la Fondation et le FONAREV en avril 2025, composée d’articles alimentaires et non alimentaires et d’appui aux secteurs de la Protection, la Santé et l’Autonomisation, destinée à couvrir les besoins des réfugiés sur une période de six mois. Le HCR assure actuellement la protection et l’assistance de plus de 110 000 réfugiés et demandeurs d’asile au Burundi, répartis dans cinq camps, un site de réfugiés et plusieurs zones urbaines, dont 20 000 réfugiés sur le site de Musenyi.À propos du HCRLe HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est mandaté pour protéger les réfugiés, les personnes déplacées internes et les apatrides, et pour rechercher des solutions durables à leurs situations.Pour plus d’information, contacter :Pour la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi : Jérémie Lebughe, jeremie.lebughe@fondationdnt.org Pour le HCR: Bernard Ntwari, ntwarib@unhcr.org; +257 79918902
1 / 5
Communiqué de presse
24 octobre 2025
Journée des Nations Unies : Message du Secrétaire Général de l'ONU
Ce ne sont pas seulement les premiers mots de la Charte des Nations Unies. Ces mots définissent qui nous sommes. L’ONU est plus qu’une institution. C’est une promesse vivante, qui transcende les frontières, jette des ponts entre les continents et constitue une source d’inspiration pour toutes les générations. Voilà quatre-vingts ans qu’ensemble, nous nous employons à forger la paix, à lutter contre la pauvreté et la faim, à promouvoir les droits humains et à bâtir un monde plus durable. Les défis qui se présentent devant nous sont formidables : montée des conflits, chaos climatique, emballement technologique, menaces contre le tissu même de notre institution. L’heure n’est pas à la timidité ou au repli. Aujourd’hui plus que jamais, le monde doit réaffirmer sa détermination à résoudre les problèmes que nul pays ne peut régler seul. En cette Journée des Nations Unies, soyons unis et réalisons l’extraordinaire promesse de vos Nations Unies. Montrons au monde ce qu’il est possible de faire lorsque « nous, peuples des Nations Unies » choisissons d’agir ensemble. ***
1 / 5
Communiqué de presse
23 octobre 2025
L’UE et le HCR lancent un projet pour des solutions durables au bénéfice des réfugiés et des communautés d’accueil au Burundi
Pour la Représentante du HCR au Burundi Mme Brigitte Mukanga Eno, « Ce projet renforcera la résilience multidimensionnelle des réfugiés congolais au Burundi ainsi que celle des communautés d’accueil, avec une attention particulière portée aux femmes et aux personnes vulnérables, dans un environnement plus sûr, plus inclusif et plus sain ». Le projet vise notamment à :Améliorer durablement l’accès aux services de base pour les réfugiés congolais du site de Musenyi et pour les communautés d’accueil : soins de santé primaires et secondaires, eau, hygiène et assainissement (EHA).Fournir des abris durables aux ménages réfugiés vulnérables et renforcer les mécanismes de protection.Soutenir les moyens de subsistance et l’autonomisation économique, en particulier pour les femmes et les personnes à besoins spécifiques notamment les personnes âgées ou vivant avec handicap. « L’Union européenne est fière de soutenir, aux côtés du HCR, des solutions durables qui conjuguent protection, accès aux services essentiels et autonomisation économique. À Musenyi et dans les environs, notre objectif est clair : améliorer concrètement la vie des personnes réfugiées et de leurs hôtes, en renforçant la cohésion sociale et la résilience locale. » a déclaré S.E. Mme Elisabetta Pietrobon, Ambassadrice de l’UE au Burundi. ContexteAu Burundi, le HCR assure la protection et l’assistance de plus de 110 000 réfugiés et demandeurs d’asile, répartis entre cinq camps, un site de réfugiés et des zones urbaines, dont environ 20 000 personnes sur le site de Musenyi.À propos de l’Union européenneL’Union européenne et ses États membres font partie des premiers donateurs d’aide humanitaire au monde. Au Burundi, l’UE soutient l’assistance aux populations réfugiés et déplacées, à travers des actions en faveur de la protection, de l’accès aux services essentiels, de la résilience et du développement durable, en partenariat avec les agences onusiennes, les autorités et la société civile. À propos du HCRLe HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est mandaté pour protéger les réfugiés, les personnes déplacées internes et les apatrides, et pour rechercher des solutions durables à leurs situations. Contacts presseDélégation de l’Union européenne au BurundiTony Nsabimana, tony.nsabimana@eeas.europa.eu, +257 22202254 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burundi Aline Irakarama, irakaram@unhcr.org; +257 71869340Amina Bouarour,bouarour@unhcr.org; +257 71459459Bernard Ntwari, ntwarib@unhcr.org; +257 79918902
1 / 5
Communiqué de presse
10 octobre 2025
Le HCR en partenariat avec le Gouvernement du Burundi procède à l'inauguration de la cinquième école fondamentale construite avec l’appui de l’Agence de Coopération Internationale (KOICA)
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, (HCR) et le Gouvernement du Burundi ont inauguré, ce mercredi, l’école fondamentale de Kigage, située en Commune de Gisuru, province de Buhumuza. Je salue la coopération agissante entre nos deux organisations et remercie le Gouvernement coréen, à travers KOICA, pour le soutien constant qu’il apporte au HCR Burundi dans ses opérations de rapatriement et de réintégration des réfugiés burundais” , a dit Brigitte Mukanga-Eno, Représentante du HCR au Burundi.Elle a ajouté que la construction de cette école constitue une contribution importante du HCR pour améliorer l’éducation des enfants burundais, y compris les enfants rapatriés. Le Gouvernement coréen, à travers son agence de Coopération internationale KOICA, continue de soutenir le HCR dans les projets de construction des abris pour les rapatriés vulnérables, la construction des écoles, ainsi que le financement de projets générateurs de revenus, à travers son projet : « De la vulnérabilité à l’autonomie, Construire des communautés sures et sécurisées ».« L’éducation est la pierre angulaire du développement durable, de la cohésion sociale et de la paix, et c'est à travers de tels investissements que nous jetons les bases d'un avenir plus brillant et plus prospère pour le Burundi’, a déclaré Nam Joohyun, Directeur Adjoint de KOICA. Le soutien de KOICA va au-delà des salles de classe ; il s’étend à la construction d’abris, aux activités génératrices de revenus et aux initiatives de développement communautaire qui contribuent à une réintégration et à des solutions durables, a-t-il ajouté. « KOICA est fière de travailler main dans la main avec le HCR, le gouvernement du Burundi et les communautés locales afin d’offrir non seulement un accès à l’éducation, mais aussi la dignité, la protection et des opportunités pour les enfants rapatriés et leurs familles », a-t-il poursuivi. Avec cette inauguration, le projet « Rapatriement volontaire et réintégration durable des réfugiés burundais (2022-2024) » est officiellement clôturé. Au cours des 30 derniers mois, cette initiative a permis le rapatriement volontaire de plus de 50,000 réfugiés burundais dans la sécurité et la dignité, la fourniture de protection d’assistance complètes, le soutien aux moyens de subsistance résilients, et la réintégration scolaire de milliers d’enfants retournés. « Grâce à des formations, un soutien aux moyens de subsistance et des projets communautaires, le programme a renforcé la cohésion sociale et créé des voies pour une réintégration durable. Ces réalisations sont le fruit d’un partenariat solide entre KOICA, le HCR, le gouvernement du Burundi et les communautés locales » a conclu Nam Joohyun. Le HCR assure au Burundi la protection et l’assistance de plus de 110,000 réfugiés et demandeurs d’asile dans cinq camps de réfugiés, un site de réfugiés et des zones urbaines. Depuis, 2017, il a également accompagné près de 260,000 rapatriés burundais dans leur retour, dont 24,520 dans la commune de Gisuru. Pour plus d’information, contacter : Bernard Ntwari, ntwarib@unhcr.org; +257 79918902 Aline Irakarama, irakaram@unhcr.org; +257 71869340 Amina Bouarour,bouarour@unhcr.org; +257 71459459
1 / 5
Dernières ressources publiées
1 / 11
1 / 11