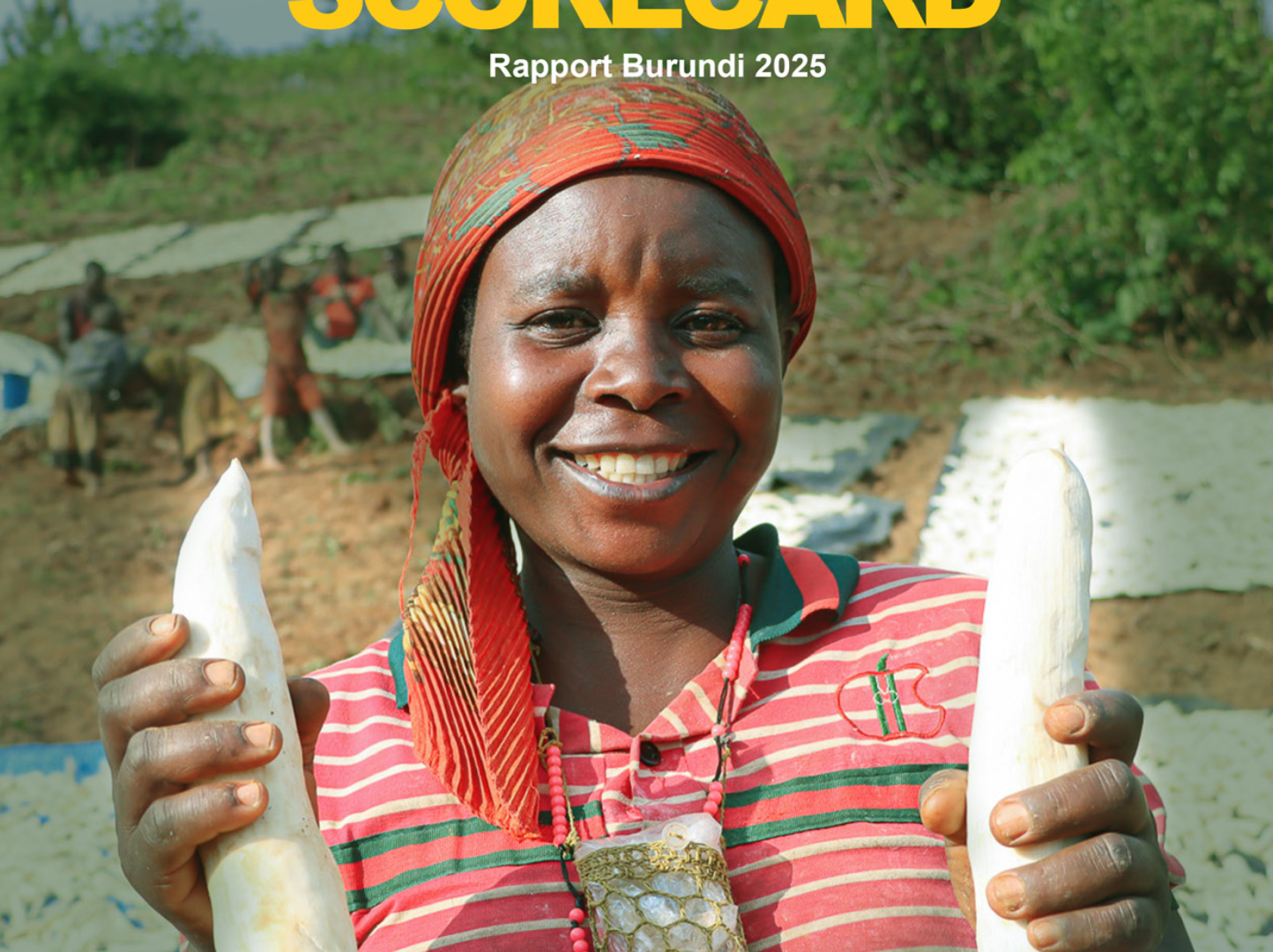Dernières actualités
Communiqué de presse
05 janvier 2026
UN Emergency Fund allocates US$3.5 million to ramp up refugee response in Burundi
Pour en savoir plus
Histoire
23 décembre 2025
Évaluation à mi-parcours du CPP 2024-2027 : des résultats prometteurs malgré l’urgence de combler le déficit financier
Pour en savoir plus
Histoire
23 décembre 2025
Burundi célèbre la Journée Internationale des Personnes Handicapées : un plaidoyer renouvelé pour des sociétés inclusives et durables
Pour en savoir plus
Dernières actualités
Les objectifs de développement durable au Burundi
Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Burundi:
Histoire
23 décembre 2025
Burundi célèbre la Journée Internationale des Personnes Handicapées : un plaidoyer renouvelé pour des sociétés inclusives et durables
“[...]le Gouvernement, les associations ainsi que vous tous devons faire de notre mieux pour que le groupe de ces personnes vulnérables soit pris en charge davantage, et soigneusement intégré dans les instances décisionnelles, chacun selon ses capacités. Ainsi, eux aussi pourront contribuer à l’unité dans le développement de notre pays.” dixit le Ministre ayant le Travail, la Fonction Publique et la Sécurité Sociale dans ses attributions, Lt General de Police Gabriel NIZIGAMA lors de la célébration nationale de la Journée Internationale des Personnes Handicapées au Burundi édition 2025.Placé cette année sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République du Burundi, par le biais du Ministère du Travail, de la Fonction Publique et de la Sécurité Sociale, en collaboration avec le Système des Nations Unies, l’événement s’est déroulé au Centre AKAMURI ce 23 décembre 2025 et a rassemblé un vaste public composé de représentants du Gouvernement, du corps diplomatique, d’agences des Nations unies, d’organisations de personnes handicapées, et de la société civile. La journée a débuté par une visite guidée du Centre AKAMURI, structure d’accueil et de réhabilitation qui accompagne au quotidien des enfants et adultes en situation de handicap intellectuel. Les invités ont pu observer diverses activités socio-éducatives et échanger avec des bénéficiaires sur leurs besoins, leurs progrès et leurs ambitions. Une pièce de théâtre, jouée par de jeunes artistes, est venue illustrer avec sensibilité la réalité de l’exclusion et la puissance de l’entraide, laissant dans l’audience une empreinte autant artistique que sociale.Dans son allocution, la représentante de la Confédération des Réseaux d’Organisations des Personnes Handicapées du Burundi (CORPHB), Mme Constance KATIHABWA, a livré un message poignant, chaleureusement salué par l’audience. Elle a exprimé reconnaissance, mais aussi des attentes concrètes envers les autorités, notamment pour une meilleure application de la loi de 2018 contre la discrimination, l’intégration accrue des personnes handicapées dans les instances décisionnelles, la mise en place de quotas d’emploi au sein de l’administration publique, ainsi qu’un investissement renforcé dans l’éducation inclusive. “Nous demandons qu’au moment de la planification et de la mise en œuvre de leurs projets, on tienne compte de la façon dont les personnes handicapées seront également impliquées dans leurs activités. Par exemple, qu’il s’agisse de la promotion des personnes, de la santé, de l’éducation, des problèmes des réfugiés, ou du soutien aux femmes dans leurs responsabilités. Il faut se rappeler que cette catégorie de personnes handicapées a besoin de mesures spécifiques afin qu’elle puisse y avoir une équité et une égalité des chances avec les autres.” ajoute-t-elle. Au nom du Système des Nations Unies, le représentant de la Coordinatrice Résidente, M. Taifourou DIALLO, a insisté sur la portée mondiale et nationale du thème 2025: “... l’inclusion n’est pas seulement un principe moral, mais un droit fondamental et un levier incontournable pour bâtir des sociétés plus justes, plus résilientes et plus prospères.” Il poursuit en disant : “Les personnes en situation de handicap sont des actrices essentielles du progrès social. Leur créativité et leur leadership contribuent à renforcer la préparation aux catastrophes, à promouvoir l’inclusion dans l’éducation et l’emploi, et à orienter les actions humanitaires vers une meilleure protection des plus vulnérables.”Il a rappelé les progrès accomplis entre 2019 et 2024 dans l’accessibilité des services, le renforcement des cadres juridiques et la participation renforcée des personnes vivant avec handicap aux processus décisionnels, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les efforts pour lever les obstacles persistants : discriminations, pauvreté, infrastructures inaccessibles. Au cours de la cérémonie, des appuis matériels ont été remis à plusieurs bénéficiaires, dont Mme Virginie MINANI, une femme en situation de handicap ayant reçu une paire de béquilles et un kit de dignité. Son témoignage, chargé d’émotion, a rappelé que l’inclusion prend tout son sens lorsqu’elle se traduit dans la vie réelle :
“Cette journée change ma vie, j’imaginais que je mourrais utilisant un simple bâton pour me déplacer, jamais je n’aurais imaginé tenir des béquilles pareilles, je pensais que c’était réservé aux plus aisés et voilà qu’aujourd’hui j’en ai reçu, je rends grâce à Dieu pour ce changement qui éclaire mon chemin !” a-t-elle déclaré.Son histoire illustre l’impact concret de cette célébration – au-delà des discours, ce sont des pas nouveaux rendus possibles, une dignité restaurée, et une confiance renouvelée. L’appui du Système des Nations Unies, conjugué à l’engagement du Gouvernement, démontre que la collaboration peut transformer des vies et faire émerger des changements tangibles dans le quotidien des personnes handicapées.De son côté, le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Sécurité Sociale est revenu sur l’importance du changement de mentalité et du principe de ne laisser personne en marge du progrès et promouvoir un leadership social collectif. ”[...] Personne ne peut ignorer qu’en ces années, il y a beaucoup de catastrophes liées au changement climatique. Cela exige que chacun, où qu’il soit, soit un leader accompli, que les personnes handicapées ne soient pas laissées pour compte, et que les mesures et plans adoptés soient dans l’intérêt de tous les Burundais, qu’ils soient utiles pour nous, sans qu’aucun groupe ne soit abandonné.” En refermant cette célébration, le Burundi réaffirme que l’inclusion ne relève ni d’un slogan ni d’un geste symbolique, mais d’un droit fondamental et d’un moteur essentiel au développement national. Les engagements exprimés et l’énergie collective portée au Centre AKAMURI ce 23 décembre 2025 traduisent la volonté de bâtir une société où chaque citoyen trouve sa place, sans barrières ni discriminations.Le Système des Nations Unies a renouvelé à cette occasion son engagement à accompagner le Gouvernement du Burundi dans le développement de programmes favorisant l’emploi, l’autonomisation socio-économique et la participation décisionnelle des personnes handicapées, dans l’esprit de la vision de 2040 et 2060. Au-delà des mots forts des discours, les engagements formulés ce jour laissent entrevoir une dynamique porteuse d’optimisme : poursuite du soutien public au développement inclusif, volonté de renforcer les cadres institutionnels, collaboration accrue avec l’ONU et les organisations locales, et perspective d’étendre l’éducation inclusive dans le pays.
“Cette journée change ma vie, j’imaginais que je mourrais utilisant un simple bâton pour me déplacer, jamais je n’aurais imaginé tenir des béquilles pareilles, je pensais que c’était réservé aux plus aisés et voilà qu’aujourd’hui j’en ai reçu, je rends grâce à Dieu pour ce changement qui éclaire mon chemin !” a-t-elle déclaré.Son histoire illustre l’impact concret de cette célébration – au-delà des discours, ce sont des pas nouveaux rendus possibles, une dignité restaurée, et une confiance renouvelée. L’appui du Système des Nations Unies, conjugué à l’engagement du Gouvernement, démontre que la collaboration peut transformer des vies et faire émerger des changements tangibles dans le quotidien des personnes handicapées.De son côté, le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Sécurité Sociale est revenu sur l’importance du changement de mentalité et du principe de ne laisser personne en marge du progrès et promouvoir un leadership social collectif. ”[...] Personne ne peut ignorer qu’en ces années, il y a beaucoup de catastrophes liées au changement climatique. Cela exige que chacun, où qu’il soit, soit un leader accompli, que les personnes handicapées ne soient pas laissées pour compte, et que les mesures et plans adoptés soient dans l’intérêt de tous les Burundais, qu’ils soient utiles pour nous, sans qu’aucun groupe ne soit abandonné.” En refermant cette célébration, le Burundi réaffirme que l’inclusion ne relève ni d’un slogan ni d’un geste symbolique, mais d’un droit fondamental et d’un moteur essentiel au développement national. Les engagements exprimés et l’énergie collective portée au Centre AKAMURI ce 23 décembre 2025 traduisent la volonté de bâtir une société où chaque citoyen trouve sa place, sans barrières ni discriminations.Le Système des Nations Unies a renouvelé à cette occasion son engagement à accompagner le Gouvernement du Burundi dans le développement de programmes favorisant l’emploi, l’autonomisation socio-économique et la participation décisionnelle des personnes handicapées, dans l’esprit de la vision de 2040 et 2060. Au-delà des mots forts des discours, les engagements formulés ce jour laissent entrevoir une dynamique porteuse d’optimisme : poursuite du soutien public au développement inclusif, volonté de renforcer les cadres institutionnels, collaboration accrue avec l’ONU et les organisations locales, et perspective d’étendre l’éducation inclusive dans le pays.
1 / 5

Histoire
23 décembre 2025
Évaluation à mi-parcours du CPP 2024-2027 : des résultats prometteurs malgré l’urgence de combler le déficit financier
La représentation de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), au Burundi a organisé, du 22 au 23 décembre 2025 à Bujumbura, un atelier d’évaluation et de vérification de la cohérence et l’alignement stratégique des projets qui ont contribué et qui contribuent à la réalisation du cadre de programmation pays de la FAO pour la république du Burundi (CPP) 2024-2027.L’atelier a rassemblé un large éventail d’acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre du CPP. Parmi eux figuraient le personnel stratégique de la FAO, incluant le bureau pays et les experts techniques ; les cadres des ministères partenaires, notamment le Ministère de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage (MINEAGRIE) et le Ministère des affaires étrangères ; les représentants du Système des Nations Unies ; les organisations non gouvernementales et organisations de la société civile ainsi que les acteurs du secteur privé agricole afin d’accroître l’impact des actions de la FAO au bénéfice de la population burundaise.L’analyse révèle que près de 50 % du budget nécessaire à la mise en œuvre du CPP ont déjà été mobilisés, laissant un déficit équivalent à combler. Malgré ce gap financier, les deux premières années ont permis de réaliser des avancées concrètes et visibles sur le terrain notamment en matière de sécurité alimentaire, de résilience climatique et de renforcement des capacités institutionnelles, témoignant de l’efficacité des interventions engagées. À l’issue de l’atelier, plusieurs recommandations ont été formulées pour renforcer l’efficacité du CPP. Elles s’articulent autour de cinq axes majeurs : intensifier la mobilisation des ressources et diversifier les partenariats ; améliorer la conception des indicateurs ainsi que leur suivi et évaluation ; capitaliser les bonnes pratiques et les déployer à grande échelle ; consolider les capacités nationales en planification, suivi-évaluation et gestion des données ; et intégrer de manière systématique les dimensions genre et nutrition dans l’ensemble des interventions.Les prochaines étapes concernent l'équipe de la FAO. « Nous devons traduire ces recommandations validées en actions concrètes et mesurables et réalistes » a souligné Apollinaire Masuguru l’Assistant du Représentant de la FAO chargé du programme. M. Masuguru a précisé qu'un rapport sur l'atelier sera partagé avec le bureau sous-régional et le bureau régional pour d'éventuels commentaires afin d'ajuster la formulation des recommandations en vue de les prendre en compte dans l'élaboration des projets futurs. En effet, les recommandations constituent un socle stratégique pour orienter les actions futures, renforcer l’impact du CPP et garantir une meilleure redevabilité vis-à-vis du Gouvernement et des partenaires.Il faut noter que l’atelier d’évaluation à mi-parcours du CPP 2024–2027 a confirmé la pertinence stratégique et l’alignement des interventions de la FAO au Burundi avec les priorités nationales. Les résultats obtenus sont encourageants, mais leur pérennité dépendra de la capacité à combler le déficit de financement, à renforcer les synergies intersectorielles et à intensifier le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers.
1 / 5

Histoire
19 décembre 2025
La FAO, Entité d’implémentation dans le cadre du projet « Pandemic Funds » renforce la mobilité et la digitalisation des services vétérinaires pour une surveillance efficace des maladies animales au Burundi
La Surveillance des maladies animales au Burundi a franchi, le lundi 16 décembre 2025, une étape cruciale. Dans le cadre du projet « Renforcement des capacités nationales de prévention, de préparation et de réponse aux urgences sanitaires grâce à l’approche « Une seule santé » au Burundi », la Représentation de la FAO au Burundi, a remis officiellement six véhicules tout terrain au ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage d’une valeur de 320 000 USD. Selon Monsieur Pissang Tchangai Dadémanao, Représentant de la FAO au Burundi, cette acquisition vise à améliorer la mobilité des équipes techniques sur le terrain, permettant ainsi des interventions rapides en cas d’épidémie et une surveillance intégrée jusque dans les zones les plus reculées du pays.En effet, cette initiative est en droite ligne avec le cadre stratégique de la FAO pour le pays, qui vise à renforcer la production animale, végétale et aquatique tout en améliorant les conditions de vie des populations. « L’initiative vient en appoint aux efforts déjà réalisés, notamment la remise de 200 tablettes pour la surveillance digitale, une trentaine d’ordinateurs portables pour la compilation des données, et l’arrivée prochaine de 80 motos et 400 vélos destinées à faciliter la collecte d’informations et d’échantillons en temps réel », a indiqué le Représentant de la FAO au Burundi. Ces équipements sont destinés à renforcer la surveillance des maladies animales, environnementales et à contribuer à la mise en œuvre de l’approche « Une seule santé », qui intègre la santé animale, humaine et environnementale.Un pas décisif pour la réponse rapide aux urgences et la digitalisation des données sanitairesDu côté du ministère de l’environnement, l’agriculture et de l’élevage (MINEAGRIE), Dr Canesius Nkundwanayo, Directeur Général Responsable du Programme Elevage et halieutiques (DGREH), représentant du ministre, a salué cette acquisition comme une avancée significative pour la mise en œuvre du projet, qui s’étend sur trois ans. « Grâce à ces véhicules, les services vétérinaires pourront désormais intervenir rapidement sur le terrain, sans dépendre des locations coûteuses et peu efficaces », s’est réjoui Dr Canesius. Le représentant du ministère salue également l’acquisition antérieur du matériel informatique pour la digitalisation des données sanitaires en l’occurrence des tablettes qui facilitent la collecte systématique et continue des informations épidémiologiques, améliorant ainsi la prise de décision et la réactivité face aux urgences.Il a également souligné l’importance des formations en cours pour renforcer les compétences des équipes techniques et des acteurs de la chaîne de valeur animale. Ces efforts conjoints entre la FAO et le gouvernement burundais marquent une étape essentielle vers une surveillance efficace des maladies animales, contribuant à la sécurité sanitaire nationale et à la conformité avec les exigences internationales.Rappelons que le projet de renforcement des capacités nationales pour la prévention, la préparation et la réponse aux urgences sanitaires avec l’approche « Une seule santé » au Burundi a été conçu pour combler les lacunes identifiées lors des évaluations internationales, notamment l’évaluation externe conjointe du RSI et PVS. Les maladies animales représentent une menace non seulement pour le secteur agricole, mais aussi pour la santé publique car 75 pour cent des maladies émergentes sont zoonotiques.
1 / 5

Histoire
18 décembre 2025
Initiative Main dans la Main au Burundi : fédération des efforts autour des filières à fort potentiel économique
L'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Burundi a organisé une Table Ronde nationale de mobilisation et de coordination des partenaires des filières prioritaires – tomate, soja, manioc, lapin - de l’Initiative Main dans la Main au Burundi. Cet événement a réuni des représentants du gouvernement, des partenaires au développement, du secteur privé et de la société civile, de acteurs clés pour la transformation des systèmes agroalimentaires. La table ronde a permis de présenter, au niveau national, la « Note d’investissement autour des filières prioritaires » pour susciter un engagement des partenaires en lien avec la vision du pays, une étape cruciale dans la mise en œuvre de l’Initiative “Main dans la Main” au Burundi. La note avait été présenté au forum mondial de l'alimentation en octobre 2025 qui a vu la participation des investisseurs étrangers à l'affût des opportunités des secteurs à investir.« Il n'y a pas que des investisseurs internationaux, il y a aussi des investisseurs au niveau national. Nous venons donc de passer un cap : celui de présenter le même produit, le même plan d'investissement aux investisseurs locaux qui sont là, car le secteur privé n'est pas qu'international, il est aussi national », a souligné Pissang Tchangai Dademanao, Représentant de la FAO au Burundi. En effet, les échanges nourris, ont porté essentiellement sur la note d’investissement, l’analyse des opportunités sectorielles, les mécanismes de montage financier, et l’intégration des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur. Des intentions d’engagements ont été manifestées. Des engagements concrets mèneront à l’élaboration d’une feuille de route opérationnelle.« Maintenant que les filières et le note d’investissement sont connues, c'est de pouvoir aller vers des projets concrets qui peuvent mobiliser des partenaires de financement pour qu'ils fassent le choix, non seulement des chaînes de valeur sur lesquelles ils peuvent investir, mais des segments de ces chaînes de valeur sur lesquelles ils peuvent trouver leur opportunité », a estimé le Représentant de la FAO.Pour atteindre cet objectif, la contribution des acteurs locaux est essentielle. « Nous invitons les investisseurs burundais à contribuer au financement du développement rural, car le secteur de l'agriculture et de l'élevage a été identifié comme un secteur clé pour ce développement », a déclaré Emmanuel Niyungeko, Secrétaire Permanent du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage.Le ministère en charge de l’agriculture et de l’élevage promet de créer des conditions favorables pour les investisseurs, de fournir un accompagnement technique et créer un cadre élargi d'échanges entre les acteurs. L'un des points forts de la table ronde a été un panel organisé dans l’optique d’instaurer un dialogue public-privé autour de l'initiative « Main dans la main » afin de renforcer le dialogue structuré entre les pouvoirs publics, les partenaires au développement et les entreprises. L'activité a permis de clarifier les rôles, les attentes, les contraintes et les engagements du secteur privé en faveur d'une transformation économique inclusive. Le panel, composée de représentants du FIDA, du PAEEJ et de la BAD, a mis en lumière les opportunités d'investissement (production, transformation, logistique, services), identifié les obstacles à l'investissement (financement, fiscalité, infrastructures, climat des affaires) et devait aboutir à des mécanismes concrets de consultation public-privé ainsi qu'à une première liste d'engagements du secteur privé à intégrer dans le cadre du suivi post-table ronde. Tous ces efforts visent en effet, dans le cadre de l’initiative, à accélérer la transformation des systèmes agricoles et à contribuer à l’élimination de la pauvreté et de la faim, conformément aux Objectifs de Développement Durable. En s’attachant au développement des filières telles que la tomate, le lapin, le manioc et le soja, le Burundi témoigne de sa volonté d’orienter ses efforts vers des chaînes de valeur ayant un fort impact économique et social sur les communautés rurales.Cette table ronde marque un tournant décisif pour l’initiative « Main dans la main » au Burundi. En fédérant les partenaires autour de filières stratégiques et en posant les bases d’un mécanisme national de coordination, elle ouvre la voie à des investissements ciblés et à des innovations capables de transformer durablement les systèmes agroalimentaires burundais. Un pari ambitieux, mais essentiel, pour une croissance inclusive et résiliente au service des communautés rurales.
1 / 5

Histoire
18 décembre 2025
Solidarité en action à Gateri : ONU Femmes Burundi aux côtés des déplacés
A Gateri, commune Bukinanya, province Bujumbura, ONU Femmes Burundi a posé un geste vital aux côtés des personnes déplacées, frappées de plein fouet par les inondations de Gatumba. Des familles entières ont tout perdu. Face à l’urgence et à la détresse, 1 016 ménages ont reçu chacun 184 800 BIF en assistance en cash, un soutien immédiat pour se nourrir, se soigner, protéger les enfants et reprendre pied après le choc.Sur le terrain, la Déléguée de la Représentante d’ONU Femmes Burundi a rappelé que cette aide est bien plus qu’un appui financier : c’est une bouffée d’oxygène, un levier de dignité et un premier pas vers la résilience. Elle a encouragé les bénéficiaires à l’utiliser avec priorité pour l’alimentation, la santé, l’éducation des enfants et des activités génératrices de revenus, afin de transformer l’urgence en espoir durable.Les autorités locales ont salué un engagement constant et salvateur, intervenant à un moment critique pour des familles contraintes de reconstruire leur vie à partir de presque rien. La voix du site de Gateri, porteuse de la reconnaissance collective, a exprimé une gratitude profonde pour cette assistance qui sauve, soutient et redonne confiance.Financée par le Fonds Central d’intervention d’urgences des Nations Unies (UN Central Emergency Response Fund - CERF/ UFE) et mise en œuvre avec l’appui de la FINBANK Burundi, cette intervention a été conduite dans le respect des principes humanitaires de transparence, de sécurité et de redevabilité.À Gateri, ONU Femmes Burundi réaffirme un message clair : aucune femme, aucune fille, aucune famille ne doit être laissée de côté. Même dans l’épreuve, la solidarité peut rallumer l’espoir et ouvrir la voie au relèvement.
1 / 5

Communiqué de presse
05 janvier 2026
UN Emergency Fund allocates US$3.5 million to ramp up refugee response in Burundi
“This timely and much-needed CERF funding will enable humanitarian partners in Burundi to rapidly scale up life-saving assistance for newly arrived refugees, stabilise overstretched reception areas, and respond immediately to the most urgent needs,” said Ms. Violet Kakyomya, the United Nations Resident Coordinator in Burundi.More than 100,000 forcibly displaced persons including about 90.000 Congolese refugees and 10.000 Burundian refugees are now estimated to have fled to Burundi since 5 December, following escalating violence in South Kivu, according to– UNHCR, as of 3rd January 2026. Arrivals through multiple entry points continue, underscoring a rapidly deteriorating situation and the urgent need to scale up humanitarian assistance.Refugees are arriving exhausted and, in some cases injured, and in urgent need of support. While commending the leadership and decision of the Government of Burundi to open it’s frontiers to refugees, grant prima facie status and relocate safely the refugees, the lifesaving assistance is much needed.“While this allocation is critical to kick-start immediate life-saving assistance, additional resources are urgently required to close gaps in shelter, health, food, safe water, sanitation and hygiene, and protection services, and to scale up cholera and other disease response efforts,” Ms. Kakyomya added.The CERF funding will support humanitarian response activities in Busuma Refugee Camp, a newly established site in eastern Burundi, set up in December, to host thousands of refugees fleeing violence in the DRC. The camp faces urgent needs in water, shelter, food, and health services, with a recent cholera outbreak underscoring the critical living conditions and public health challenges on the ground.On 17 December, the Government of Burundi declared a state of emergency and, together with UN agencies, launched a Joint UN Response Plan and Flash Appeal to address the growing influx of refugees. The UN Refugee Agency has launched a US$47.2 million appeal to assist 500,000 internally displaced people in the DRC and up to 166,000 refugees expected in Burundi, Rwanda, and other neighbouring countries over the next four months.
1 / 5
Communiqué de presse
04 novembre 2025
Le Burundi accueille la 21ᵉ Réunion stratégique régionale sur les risques liés aux matières dangereuses chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (NRBC)
L’engagement du Burundi et de ses partenaires Du 4 au 6 novembre, le Gouvernement du Burundi a accueilli à Bujumbura la 21ᵉ Réunion stratégique régionale réunissant onze pays d’Afrique centrale et orientale. Cette rencontre visait à partager les expériences nationales sur la gestion des risques liés aux substances chimiques, aux maladies et aux matières radioactives, ainsi qu’à renforcer la coopération régionale dans ce domaine. L’événement a été organisé dans le cadre de l’Initiative des Centres d’Excellence de l’Union européenne pour l’atténuation des risques NRBC (EU CBRN CoE), à laquelle le Burundi a adhéré comme pays partenaire en 2013. Financée par l’Union européenne, depuis sa création en 2010 cette initiative soutient les pays partenaires dans le renforcement de la coordination, le renforcement des capacités et l’élaboration de politiques visant à réduire les risques liés aux matières dangereuses. Sa mise en œuvre est appuyée par l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI). Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Syldie MANIREREKANA, Assistant du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au Développement, a souligné l’engagement du Burundi à œuvrer pour une Afrique centrale et orientale plus sûre, plus résiliente et plus solidaire, capable de prévenir les crises liées aux matériaux dangereuses plutôt que de les subir. La Délégation de l’Union européenne au Burundi était représentée par Mme Laure DREGE, Cheffe de la coopération par intérim, qui a rappelé que la sécurité NRBC dans la région contribue directement à la sécurité et à la prospérité mondiale. Elle a insisté sur le caractère partenarial et collaboratif de l’appui de l’Union européenne, fondé sur le respect mutuel, l’apprentissage partagé et la recherche conjointe de solutions. Mme Clara ANYANGWE, Représentante résidente d’ONU Femmes, s’exprimant au nom de la Coordonnatrice résidente des Nations Unies pour le Burundi, a salué l’esprit de collaboration et de proactivité incarné par l’Initiative CBRN CoE de l’Union européenne face à la complexité croissante des menaces NRBC dans un monde en constante évolution. Elle a également indiqué que le Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable du Burundi comprend plusieurs points de convergence avec les priorités du NRBC.Les discussions lors de la réunion ont également porté sur l’impact des projets régionaux financés par l’Union européenne, qui visent notamment la gestion sûre des déchets chimiques, le renforcement de la biosécurité et de la sûreté biologique, la formation et la préparation des premiers intervenants, ainsi que la fourniture d’équipements techniques spécialisés aux pays partenaires. Les échanges interactifs ont permis d’identifier les priorités régionales, d’évaluer les défis rencontrés et de formuler des pistes de collaboration future. Un partenariat solide entre le Burundi, l’Union européenne et les Nations uniesEn amont de la réunion, le Gouvernement du Burundi a reçu le Bureau régional pour l’Afrique centrale et orientale de l’Initiative CBRN CoE de l’Union européenne, pour réaffirmer le partenariat de longue date entre le Burundi et l’Initiative. Le Secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au Développement, M. Ferdinand BASHIKAKO, a rencontré le Directeur du Bureau régional, M. James CHUMBA, et son équipe. M. Bashikako a mis en avant le défi majeur que les risques NRBC restent méconnus, qui peut exposer les populations à des dangers involontaires. La Protection civile en première ligne La Protection Civile du Burundi est le principal bénéficiaire des équipements techniques NRBC fournis par l’Union européenne. Deux de ses cadres suivent actuellement le programme de master en gestion NRBC développé grâce à l’Initiative CBRN CoE de l’UE, en partenariat avec des universités du Maroc et de la France. Le Général de Brigade de Police Célestin NIBONA BONANSIZE, Assistant du ministre de l’Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, a exprimé la gratitude du Gouvernement burundais pour les appuis fournis par l’Union européenne, qui contribuent au renforcement des capacités nationales face aux risques d’accidents et d’incidents impliquant des matières dangereuses. L’Initiative CBRN CoE de l’Union européenne œuvre à la création d’un monde plus sûr et plus résilient à travers la coopération avec 63 pays partenaires, dont 28 en Afrique, répartis dans huit régions du monde. Les réseaux régionaux d’experts jouent un rôle central dans la définition et la mise en œuvre de formations ciblées visant à renforcer la réduction des risques NRBC. Lancée en 2010, l’Initiative, mise en œuvre conjointement par la Commission européenne et l’UNICRI, vise à renforcer les capacités nationales pour prévenir, se préparer, répondre et se relever des incidents NRBC. Cette année marque le 15ᵉ anniversaire de l’Initiative CBRN CoE, témoignant de l’engagement commun de l’Union européenne, des Nations Unies et des pays partenaires à œuvrer ensemble pour rendre le monde plus sûr. Pour plus d’informations : https://cbrn-risk-mitigation.network.europa.eu
1 / 5
Communiqué de presse
01 novembre 2025
Remise d’un don aux réfugiés congolais au Burundi par le HCR et la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi
La cérémonie s’est déroulée en présence de Madame Brigitte Mukanga Eno, Représentante du HCR au Burundi, qui a salué cette initiative :« Cette assistance arrive à point nommé, alors que l’aide humanitaire destinée aux réfugiés, tant au niveau mondial qu’au Burundi, connaît une baisse significative. Elle permettra de compléter l’assistance alimentaire fournie par le PAM durant les deux prochains mois. » Le don remis aujourd’hui représente un premier lot de 472 tonnes de vivres, comprenant de la farine de maïs et de soja, des haricots, du riz, de l’huile, du sucre et du sel. Ce don a été financé par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et le Fonds National des Réparations des Victimes de Violences Sexuelles liées aux Conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (FONAREV). La distribution a été assurée par African Initiatives for Relief and Development (AIRD), partenaire du HCR au Burundi.Madame Katty Emilie Massoulis a exprimé l’engagement de la Fondation :« Nous avons été profondément interpellés par la situation de nos compatriotes déplacés par le conflit. C’est avec émotion et solidarité que nous apportons notre contribution pour les soutenir durant cette période difficile. » Ce don fait suite à une première assistance octroyée par la Fondation et le FONAREV en avril 2025, composée d’articles alimentaires et non alimentaires et d’appui aux secteurs de la Protection, la Santé et l’Autonomisation, destinée à couvrir les besoins des réfugiés sur une période de six mois. Le HCR assure actuellement la protection et l’assistance de plus de 110 000 réfugiés et demandeurs d’asile au Burundi, répartis dans cinq camps, un site de réfugiés et plusieurs zones urbaines, dont 20 000 réfugiés sur le site de Musenyi.À propos du HCRLe HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est mandaté pour protéger les réfugiés, les personnes déplacées internes et les apatrides, et pour rechercher des solutions durables à leurs situations.Pour plus d’information, contacter :Pour la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi : Jérémie Lebughe, jeremie.lebughe@fondationdnt.org Pour le HCR: Bernard Ntwari, ntwarib@unhcr.org; +257 79918902
1 / 5
Communiqué de presse
24 octobre 2025
Journée des Nations Unies : Message du Secrétaire Général de l'ONU
Ce ne sont pas seulement les premiers mots de la Charte des Nations Unies. Ces mots définissent qui nous sommes. L’ONU est plus qu’une institution. C’est une promesse vivante, qui transcende les frontières, jette des ponts entre les continents et constitue une source d’inspiration pour toutes les générations. Voilà quatre-vingts ans qu’ensemble, nous nous employons à forger la paix, à lutter contre la pauvreté et la faim, à promouvoir les droits humains et à bâtir un monde plus durable. Les défis qui se présentent devant nous sont formidables : montée des conflits, chaos climatique, emballement technologique, menaces contre le tissu même de notre institution. L’heure n’est pas à la timidité ou au repli. Aujourd’hui plus que jamais, le monde doit réaffirmer sa détermination à résoudre les problèmes que nul pays ne peut régler seul. En cette Journée des Nations Unies, soyons unis et réalisons l’extraordinaire promesse de vos Nations Unies. Montrons au monde ce qu’il est possible de faire lorsque « nous, peuples des Nations Unies » choisissons d’agir ensemble. ***
1 / 5
Communiqué de presse
23 octobre 2025
L’UE et le HCR lancent un projet pour des solutions durables au bénéfice des réfugiés et des communautés d’accueil au Burundi
Pour la Représentante du HCR au Burundi Mme Brigitte Mukanga Eno, « Ce projet renforcera la résilience multidimensionnelle des réfugiés congolais au Burundi ainsi que celle des communautés d’accueil, avec une attention particulière portée aux femmes et aux personnes vulnérables, dans un environnement plus sûr, plus inclusif et plus sain ». Le projet vise notamment à :Améliorer durablement l’accès aux services de base pour les réfugiés congolais du site de Musenyi et pour les communautés d’accueil : soins de santé primaires et secondaires, eau, hygiène et assainissement (EHA).Fournir des abris durables aux ménages réfugiés vulnérables et renforcer les mécanismes de protection.Soutenir les moyens de subsistance et l’autonomisation économique, en particulier pour les femmes et les personnes à besoins spécifiques notamment les personnes âgées ou vivant avec handicap. « L’Union européenne est fière de soutenir, aux côtés du HCR, des solutions durables qui conjuguent protection, accès aux services essentiels et autonomisation économique. À Musenyi et dans les environs, notre objectif est clair : améliorer concrètement la vie des personnes réfugiées et de leurs hôtes, en renforçant la cohésion sociale et la résilience locale. » a déclaré S.E. Mme Elisabetta Pietrobon, Ambassadrice de l’UE au Burundi. ContexteAu Burundi, le HCR assure la protection et l’assistance de plus de 110 000 réfugiés et demandeurs d’asile, répartis entre cinq camps, un site de réfugiés et des zones urbaines, dont environ 20 000 personnes sur le site de Musenyi.À propos de l’Union européenneL’Union européenne et ses États membres font partie des premiers donateurs d’aide humanitaire au monde. Au Burundi, l’UE soutient l’assistance aux populations réfugiés et déplacées, à travers des actions en faveur de la protection, de l’accès aux services essentiels, de la résilience et du développement durable, en partenariat avec les agences onusiennes, les autorités et la société civile. À propos du HCRLe HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est mandaté pour protéger les réfugiés, les personnes déplacées internes et les apatrides, et pour rechercher des solutions durables à leurs situations. Contacts presseDélégation de l’Union européenne au BurundiTony Nsabimana, tony.nsabimana@eeas.europa.eu, +257 22202254 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burundi Aline Irakarama, irakaram@unhcr.org; +257 71869340Amina Bouarour,bouarour@unhcr.org; +257 71459459Bernard Ntwari, ntwarib@unhcr.org; +257 79918902
1 / 5
Dernières ressources publiées
1 / 11
1 / 11