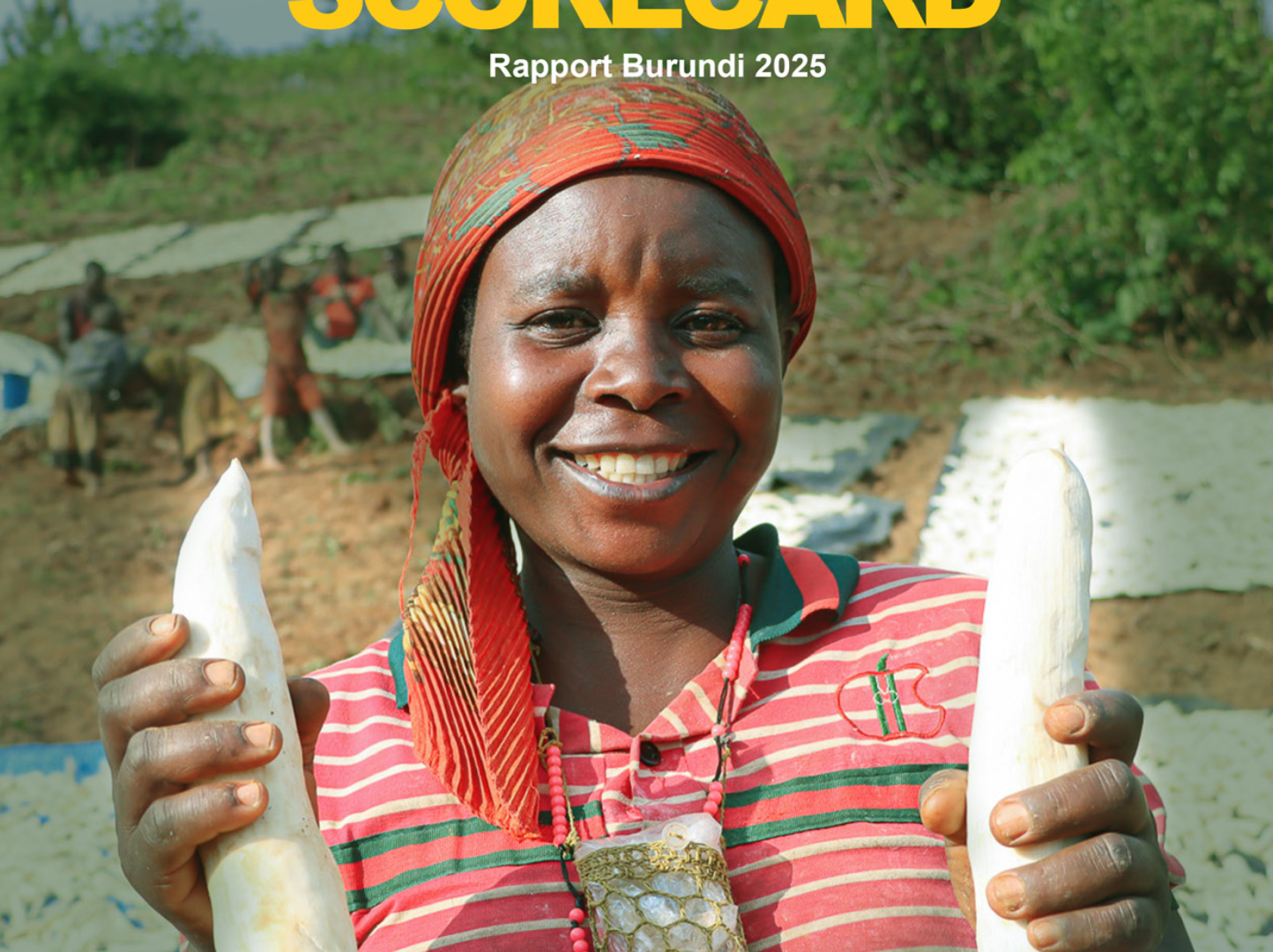Dernières actualités
Communiqué de presse
10 octobre 2025
Le HCR en partenariat avec le Gouvernement du Burundi procède à l'inauguration de la cinquième école fondamentale construite avec l’appui de l’Agence de Coopération Internationale (KOICA)
Pour en savoir plus
Communiqué de presse
07 octobre 2025
Améliorons-nous ensemble : Bâtir les systèmes agroalimentaires de demain grâce aux quatre améliorations
Pour en savoir plus
Histoire
30 septembre 2025
Briser les murs du silence : Les Nations Unies au Burundi s'initie à la langue des Signes pour une inclusion durable
Pour en savoir plus
Dernières actualités
Les objectifs de développement durable au Burundi
Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Burundi:
Histoire
30 septembre 2025
Briser les murs du silence : Les Nations Unies au Burundi s'initie à la langue des Signes pour une inclusion durable
Dans le cadre de leurs engagements en faveur des droits humains et de l’égalité, les Nations Unies au Burundi intensifient la mise en œuvre de la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap, adoptée en 2019. Le Bureau de la Coordonnatrice Résidente a organisé le 30 septembre 2025 une session de sensibilisation à l’endroit du personnel et du staff du Système des Nations Unies au Burundi sur le langage des signes. Cette initiative vise à renforcer l’accessibilité de la communication et à favoriser une inclusion réelle des personnes sourdes et malentendantes dans toutes les activités des Nations Unies.Organisée en marge de la Semaine internationale des personnes sourdes et de la Journée internationale des langues des signes, cette action réaffirme l'engagement des Nations Unies à respecter les droits et la dignité de tous. Elle est particulièrement pertinente au Burundi, où les personnes vivant avec la surdité font face à des obstacles significatifs pour l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux services de santé en raison des barrières de communication et de la stigmatisation. Démystifier et valoriser : La culture Sourde au cœur de la session. La session, qui a eu lieu à la Salle RIRIKUMUTIMA du Compound du PNUD, a été articulée autour de deux phases distinctes. La première partie, théorique, visait à déconstruire les préjugés. Le mot d'ouverture du Représentant de la Coordonnatrice Résidente a souligné l'importance du thème de la journée internationale de la langue des signes : « Défendez les droits des langues des signes ». Les présentations ont permis de comprendre les concepts clés comme : La surdité est une identité culturelle et non une pathologie ou un handicap ; les langues des signes sont des moyens de communication équivalents à toute autre langue parlé ; l'alignement sur l'Article 21 de la CRDPH, qui promeut l'utilisation de la langue des signes ; l'adoption du modèle social/des droits humains par rapport au modèle médical/caritatif et le rappel du principe fondamental :« Rien sur nous sans nous ». De la théorie à la pratique : L'initiation à la langue des Signes BurundaisLa seconde phase, un atelier pratique animé par des facilitateurs de l’Association Nationale des Sourds du Burundi (ANSB), a permis une initiation aux fondamentaux de la Langue des Signes Burundaise (LSB) et de mieux comprendre les enjeux liés à la communication inclusive.L'apprentissage s'est concentré sur des signes et expressions de base essentiels dans les contextes professionnel et humanitaire des Nations Unies : L'alphabet dactylographique en LSB, les salutations, les mots clés comme paix, sécurité, développement, résilience, etc. Des phrases permettant de demander de l'aide ou de signaler des cas de violence (physique ou psychologique) auprès des personnes sourdes, notamment dans les camps ou parmi les personnes déplacées. Un engagement pérenne pour une organisation juste et équitable En définitive, cette session de sensibilisation et d’initiation à la langue des Signes Burundaise (LSB) est bien plus qu'une simple formation. Elle marque un tournant stratégique en réaffirmant l'engagement ferme du Système des Nations Unies au Burundi à respecter les droits et la dignité des personnes vivant avec le handicap. L'appropriation des bases de la culture Sourde et de la LSB par le personnel est essentielle pour garantir l'efficacité de nos interventions sur le terrain, en particulier pour les populations vulnérables. En levant concrètement les barrières de communication, nous nous assurons que le principe fondamental, « Rien sur nous sans nous », est respecté, et que les besoins des personnes sourdes sont pleinement intégrés. Cette formation constitue une première étape vers l’intégration systématique de pratiques inclusives dans les réunions, événements officiels et services d’accueil.Cet exercice a mis en lumière trois impératifs : maintenir les séances de sensibilisation, intégrer la consultation des associations de personnes sourdes en amont des projets, et généraliser la pratique des langues des signes au quotidien. En soutenant cet effort continu, les barrières de communication seront éliminées, accélérant ainsi l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour toute la communauté Burundaise, et construisant un environnement de travail et un impact humanitaire plus juste, accessible et pleinement inclusif. L’accessibilité ne se limite pas seulement aux infrastructures ; elle repose aussi sur la capacité à communiquer avec chacun, dans sa langue, y compris le langage des signes. C’est un engagement concret pour ne « laisser personne de côté » !Quelques photos illustrant la session
1 / 5

Histoire
26 septembre 2025
Unis pour un avenir meilleur : Renforcement des Capacités des acteurs pour une agriculture et les systèmes alimentaires inclusifs au Burundi
Du 24 au 26 septembre 2025, Gitega a abrité un atelier crucial organisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en collaboration avec le Gouvernement du Burundi à travers le Secrétariat Exécutif Permanent de la Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et Nutrition "SEP/PMSAN. Cet événement a réuni des acteurs clés du Burundi autour d’un objectif commun : développer les compétences sur les enjeux de l’agriculture et des systèmes alimentaires sensibles au genre et à la nutrition.Tenu dans un contexte où investir dans la Nutrition devient le seul moyen véritable pour atteindre les objectifs du Développement durable au Burundi, cet atelier a mis en lumière l’importance d’une approche multisectorielle et inclusive pour déclencher une transformation durable de l’agriculture et les systèmes alimentaires au service de la santé et de l’équité.Dans son discours d’ouverture, M. Pissang Tchangai Dadémanao, Représentant de la FAO au Burundi a indiqué que dans le contexte burundais, il est essentiel de repenser l’agriculture et les systèmes alimentaires en intégrant les dimensions de genre et de nutrition. « Il ne suffit pas de produire davantage, mais il faut produire autrement : Orienter les efforts vers une production agricole qui garantisse une alimentation saine, diversifiée, accessible et adaptée aux besoins nutritionnels de toutes et tous sans laisser personne de côté », a-t-il déclaré. M.Pissang a souligné l’importance d’une approche multisectorielle qui englobe toutes les parties prenantes en l’occurrence les acteurs locaux, les institutions publiques et les partenaires techniques et financier. Formatrice dans l’atelier, Mme Aissa Mamadoultaibou, chargée de nutrition au bureau sous-régional de la FAO, a souligné l’importance de ce rendez-vous de renforcement des capacités qui a réuni plusieurs acteurs locaux, ceux de la société civile, des différents ministères et des agences du système des Nations Unies. « La nutrition et la sécurité alimentaire sont l’affaire de tous » a-t-elle déclaré. Elle a martelé que cette formation offre aux acteurs une compréhension commune des enjeux nutritionnels et alimentaires, en mettant en lumière le rôle essentiel de chacun dans l’amélioration des systèmes alimentaires au Burundi.Coté gouvernement, M. Célestin Sibomana, secrétaire exécutif permanent de la plateforme multisectorielle de sécurité alimentaire et nutritionnelle, affirme que, à travers un engagement politique fort, le pays a placé le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au cœur de ses priorités au niveau national.L’Importance du genre dans les Systèmes alimentairesUne des thématiques centrales développées dans l’atelier était le rôle des femmes dans les systèmes alimentaires. Pour le cas du Burundi, les femmes, en tant que productrices et préparatrices de nourriture, occupent une place fondamentale dans la chaîne alimentaire. Pourtant, il a été constaté qu’elles continuent de faire face à des obstacles structurels qui freinent leur accès aux ressources, à la formation et à la prise de décision. L’atelier a mis en exergue que surmonter cette injustice est non seulement essentiel pour améliorer la nutrition des familles, mais également pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Cela étant, la création d’un environnement favorable bâtit une société plus résiliente et juste. L’engagement des ministères, des organisations de la société civile, des agences des Nations Unies et des médias a été estimé crucial pour construire un réseau de collaboration efficace.Vers une Gouvernance Multisectorielle et CollaborativeLa transformation des systèmes alimentaires requiert une coordination efficace entre les différents secteurs. La création de la plateforme multisectorielle de sécurité alimentaire et nutritionnelle permet de rassembler les acteurs clés, notamment les ministères, les organisations de la société civile et les agences des Nations Unies. Cette gouvernance multisectorielle est essentielle pour relever les défis complexes liés à la nutrition et à la sécurité alimentaire. Comme l’a noté Pissang Tchangai, « le Burundi a un avantage, un atout, qui est celui d’avoir une structure de coordination sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. »Les différents acteurs regroupés dans l’atelier ont eu une même compréhension de ce qu’on entend par tous les éléments de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Le bagage acquis permis à chacun de percevoir le rôle qu'il peut jouer dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Burundi. Chaque session a visé à fournir des outils concrets et des idées nouvelles pour impulser le changement vers une nutrition améliorée pour tous. En surmontant les inégalités et en adoptant une approche multisectorielle, le pays se positionne pour non seulement améliorer la nutrition des familles, mais aussi bâtir une société plus résiliente et juste. Pour cela, un engagement collectif est nécessaire. L’affirme Dr. Sibomana : «atteindre le niveau souhaité nécessite des efforts multidimensionnels à l’échelle individuelle, communautaire et nationale. »Au nom des partenaires techniques et financiers du Gouvernement burundais, le Représentant de la FAO au Burundi s’est réjoui des résultats de l’atelier et a réaffirmé l’engagement de la FAO à accompagner l’intégration des principes d’une agriculture et de systèmes alimentaires sensibles au genre et à la nutrition dans les politiques publiques, les plans d’action et les programmes de développement du Burundi.Des orientations pour les prochaines étapesPour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burundi, l’atelier a émis des orientations. Primo, Il est essentiel d’intégrer davantage la nutrition dans les politiques agricoles, environnementales, sanitaires et sociales. Secundo, il est impératif renforcer la prise en compte du genre et de la jeunesse dans les initiatives dédiées à ce domaine. Tertio, il convient de développer et de consolider les filets sociaux ainsi que les cantines scolaires, qui représentent des outils durables de protection nutritionnelle. Enfin, il est crucial de promouvoir les synergies entre les différents secteurs, tels que l’eau-assainissement, le genre et la protection sociale, afin de maximiser l’impact sur la nutrition et d’assurer un avenir meilleur pour tous.Cet atelier, qui s’est déroulé sur trois jours, marque une étape importante dans le renforcement des capacités nationales et contribue à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burundi.
1 / 5
Histoire
09 septembre 2025
De l’urgence à la stabilité : La résilience communautaire en action
L’espoir de mener une vie acceptable renaît chez les familles vulnérables déplacées, retournées et familles d’accueil en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les provinces de Bujumbura, Cibitoke et Rumonge. Tel est le résultat des actions du projet de réponse aux besoins urgents et persistants en sécurité alimentaire de ces communautés vulnérables dans ces circonscriptions administratives à travers le fonds CERF (Central Emergency Response Fund). Depuis le début de l’année-2025, le projet mène des activités auprès de 3000 ménages, notamment la distribution d’intrants agricoles (semences et outils) et kits d’élevage cunicole pour les aider à sortir de la vulnérabilité et renforcer leur résilience face aux chocs climatiques.L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à travers ce projet, a distribué dans les groupements communautaires des semences de cultures maraîchères, en l’occurrence les choux, les aubergines, les amarantes, les tomates, les carottes et les oignons accompagnés d’outils aratoires (houes, râteaux et arrosoirs), tout en assurant la formation et l’encadrement de proximité par l’entremise de ses partenaires de mise en œuvre (PMO). Les résultats sont spectaculaires.Sur la voie de la résilienceFin août, lors d’une descente conjointe – FAO et PMO - d’appui et de supervision des activités, la coordination du projet a constaté qu’en si peu de temps, les résultats obtenus suscitent l’enthousiasme des bénéficiaires.« Au début du mois de juillet, nous avons eu notre première récolte d’amarantes. Nous l’avons vendue et obtenu plus de 400 000 FBu. Pour d’autres spéculations, nous n’avons pas encore commencé à récolter », témoigne Nshimirimana Désiré, président d’un groupement de 24 personnes dans la nouvelle commune de Muhuta. Ce groupement se structure avec des organes tels que le comité de gestion et le secrétariat pour s’inscrire dans la durée. À la colline de Vugizo, dans l’ancienne commune de Mutimbuzi, un groupement de 32 personnes projette d’obtenir plus de 4 000 000 FBU de la vente des tomates plantées sur une superficie de 40mx20m, en plus des choux et des oignons que le groupement a développés. « C’est vraiment le développement chez nous ! Auparavant, nous ne savions pas que nous pouvions nous réunir et mener des activités agricoles à une telle échelle», a témoigné Jean Marie Ndayikeza, président du groupement, qui souligne que cette expérience sera capitalisée au sein de leurs ménages.Au site de déplacés de Gateri, l’inattendu s’est produit. Ces victimes des inondations et des intempéries, principalement de la zone Gatumba, se sont lancées dans des activités agricoles grâce à l’appui du projet. Chaque ménage a un jardin de case et une coopérative de producteurs de 102 personnes, composée de 60 femmes, 22 jeunes et 20 hommes, s’est déjà formée. Celle-ci développe des cultures maraîchères sur des superficies plus larges.« Quand on m’a donné une parcelle, j’ai pensé directement à comment nourrir ma famille. J’ai donc semé les semences données par la FAO. Dans mon jardin, j’ai déjà récolté une fois. Une partie a été consommée et l’autre a été vendue, ce qui m’a permis d’obtenir 30 000 FBu », a indiqué Emelyne Izompa, présidente de la coopérative agricole “Abahuzamigambi mbonakazoza Uburundi butagase” au site de Gateri. Cela illustre la réussite de la résilience même dans des conditions difficiles.Tout près du butLes actions du projet conduisent tout droit vers les objectifs fixés. « Quand nos enfants consomment des légumes, les maladies carentielles diminuent. Je remercie la FAO qui forme, à travers les activités du projet, les agriculteurs sur l’intérêt de cultiver des cultures maraîchères et leur utilité sur le plan nutritionnel », a apprécié M. Savin Nsabimana, responsable de la formation et de la vulgarisation agricole au Bureau provincial de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage à Rumonge. Il souligne que, grâce aux actions du projet, le changement psychologique des agriculteurs sur le volet nutrition est déjà visible. " Les bénéficiaires ont bien utilisé les intrants agricoles et le kit d’élevage que la FAO leur a fournis à travers le fonds CERF (Central Emergency Response Fund) octroyé par OCHA", salue Dr Kalo Ouattara, coordinateur du projet. Il indique avoir constaté que les bénéficiaires sont devenus résilients et ont pu diversifier leurs sources de revenus. Il estime que s’ils continuent sur cet élan, avec l’accompagnement des PMO, ils vont assurément améliorer leurs conditions de vie.
1 / 5
Histoire
26 août 2025
Burundi – Législature 2025–2030 : les femmes renforcent leur place dans les institutions nationales
ONU Femmes au Burundi salue la nouvelle composition du Sénat et de l’Assemblée nationale pour la législature 2025–2030, révélée par la Cour Constitutionnelle, qui témoigne de progrès notables dans la représentation féminine au Burundi.Selon l’arrêt RCCB 458, le Sénat comptera 13 membres élus et cooptés, dont 6 femmes (46,15 %) et 7 hommes (53,85 %). Ce taux, bien au-dessus du quota constitutionnel de 30 %, constitue une quasi-parité historique et reflète des avancées significatives vers l’égalité des genres dans les instances décisionnelles.L’Assemblée nationale, conformément à l’arrêt RCCB 453 du 20 juin 2025, se composera de 111 députés : 43 femmes (38,74 %) et 68 hommes (61,26 %). Malgré la réduction du nombre total de sièges par rapport à 2020, la proportion de femmes reste stable et supérieure au minimum légal.La représentation féminine s’étend également à l’exécutif provincial, avec la nomination d’une femme parmi les 5 nouveaux gouverneurs, soit 20 % des postes à ce niveau.Pour ONU Femmes, ces résultats confirment que le Burundi dépasse le seuil constitutionnel en matière de participation féminine et se rapproche progressivement de la parité réelle. L’organisation encourage à poursuivre les efforts pour consolider ces acquis et garantir que les femmes puissent pleinement exercer leur rôle dans la prise de décision politique.En résumé :Sénat : 46,15 % de femmesAssemblée nationale : 38,74 % de femmesGouverneurs : 20 % de femmesONU Femmes félicite le Burundi pour ces avancées et réaffirme son engagement à travailler aux côtés des institutions nationales, de la société civile et des partenaires pour promouvoir une gouvernance inclusive et égalitaire.Ces chiffres montrent que le Burundi ne se contente pas de respecter le quota constitutionnel de 30 % de femmes dans les institutions élues, mais qu’il tend à le dépasser, notamment au Sénat. Toutefois, la parité réelle reste un objectif à atteindre. Les avancées constatées pourraient servir de levier aux acteurs politiques, à la société civile et aux partenaires internationaux pour encourager et soutenir une participation féminine encore plus forte lors des prochaines échéances électorales.Une trajectoire positive qui témoigne d’un engagement croissant en faveur de l’égalité des genres dans la gouvernance burundaise.
1 / 5

Histoire
15 août 2025
Le Burundi en route vers la mise en place d’une plateforme nationale « Une seule santé »
Sur financement des fonds de Pandemic Fund, le gouvernement du Burundi en en collaboration avec ses partenaires a organisé du 04 au 09 août 2025 dans la ville de Gitega, capitale politique, un atelier stratégique visant le renforcement de la collaboration intersectorielle selon l’approche « une seule santé » notamment dans la lutte contre les zoonoses et autres menaces sanitaires.Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités du pays en matière de prévention, de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, en intégrant les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale. Organisé sur base de l’évaluation du règlement Sanitaire International (RSI 2005) et des performances des services vétérinaires (PVS), l’atelier a mobilisé un large éventail d’acteurs multisectoriels, avec une forte représentation des hautes instances du pays dont la Présidence de la République, la Primature, le Parlement, le Sénat, ce qui témoigne de l’engagement politique en faveur de l’approche « Une seule santé ». Les agences du système des Nations Unies, notamment l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l’organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA) ainsi que des experts nationaux et internationaux des secteurs concernés ont soutenus cet atelier de cinq jours.Au nom de tous les partenaires dont la FAO et la quadripartie, le représentant de l'OMS, le Dr Xavier Crespin, anticipait déjà dans son discours d'ouverture de l’atelier sur les résultats de la réunion, précisant qu'une feuille de route claire et un engagement fort permettront la mise en place d'un mécanisme de coordination « Une seule santé », un des piliers clés est la Plateforme. Il a souligné l’importance de mettre en place une plateforme ‘Une seule santé’ fonctionnelle qui «permettra de bâtir un système de santé robuste, capable de prévenir, détecter et répondre efficacement aux urgences sanitaires, dans un esprit de solidarité, de collaboration et de responsabilité partagée ».Une feuille de route mise en placeLes activités de l’atelier ont permis de définir cinq domaines techniques prioritaires comme point de départ pour la mise en œuvre de l’approche « Une seule santé » : La coordination et la législation pour la mise en place d’organes de gouvernance multisectoriels à travers l’élaboration du décret de création de la plateforme « Une Seule santé »;La surveillance, l’investigation et le laboratoire devant conduire à la mise en place d'un système intégré de surveillance épidémiologique ;Les ressources humaines à travers l’éducation et la formation dans le but de renforcer les capacités sur l'approche « Une seule santé » dans tous les secteurs concernés, l’amélioration de la gestion intégrée des ressources humaines ;La mise en place de mécanismes coordonnés de mobilisation des fonds d’urgence permettant une réponse rapide et efficace aux urgences de santé publique;La communication (avec les médias et les partenaires) pour renforcer la collaboration multisectorielle selon l'approche "une seule santé".Les prochaines étapesLes participants à l’atelier ont défini les prochaines étapes. Il s’agit de la mise en place de la plateforme « Une seule santé », la cartographie des acteurs « Une seule santé », l’organisation d’un atelier d’orientation des décideurs et de sensibilisation des acteurs, l’élaboration de la stratégie nationale « Une seule santé », la dotation au pays d'un plan multisectoriel « Une seule santé », la mise en place d’un plan multisectoriel de renforcement des capacités des ressources humaines et la mise à jour du plan d'action national de sécurité sanitaire. Selon Dr Tieble Traoré, un des experts facilitateurs et responsable de l'approche « One Health » dans la région Afrique de l’OMS qui a pris part audit atelier, « La coordination intersectorielle est essentielle pour prévenir et gérer les maladies émergentes et ré-émergentes, dont plus de 75 % sont d’origine zoonotique».Avec les succès de cet atelier, le Burundi se dote d’une base pour la mise en place de la plateforme nationale « Une seule santé » fonctionnelle. La réussite de l’atelier de Gitega, a témoigné la volonté partagée entre le gouvernement du Burundi et ses partenaires pour construire un système de santé résilient, inclusif et durable.
1 / 5

Communiqué de presse
10 octobre 2025
Le HCR en partenariat avec le Gouvernement du Burundi procède à l'inauguration de la cinquième école fondamentale construite avec l’appui de l’Agence de Coopération Internationale (KOICA)
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, (HCR) et le Gouvernement du Burundi ont inauguré, ce mercredi, l’école fondamentale de Kigage, située en Commune de Gisuru, province de Buhumuza. Je salue la coopération agissante entre nos deux organisations et remercie le Gouvernement coréen, à travers KOICA, pour le soutien constant qu’il apporte au HCR Burundi dans ses opérations de rapatriement et de réintégration des réfugiés burundais” , a dit Brigitte Mukanga-Eno, Représentante du HCR au Burundi.Elle a ajouté que la construction de cette école constitue une contribution importante du HCR pour améliorer l’éducation des enfants burundais, y compris les enfants rapatriés. Le Gouvernement coréen, à travers son agence de Coopération internationale KOICA, continue de soutenir le HCR dans les projets de construction des abris pour les rapatriés vulnérables, la construction des écoles, ainsi que le financement de projets générateurs de revenus, à travers son projet : « De la vulnérabilité à l’autonomie, Construire des communautés sures et sécurisées ».« L’éducation est la pierre angulaire du développement durable, de la cohésion sociale et de la paix, et c'est à travers de tels investissements que nous jetons les bases d'un avenir plus brillant et plus prospère pour le Burundi’, a déclaré Nam Joohyun, Directeur Adjoint de KOICA. Le soutien de KOICA va au-delà des salles de classe ; il s’étend à la construction d’abris, aux activités génératrices de revenus et aux initiatives de développement communautaire qui contribuent à une réintégration et à des solutions durables, a-t-il ajouté. « KOICA est fière de travailler main dans la main avec le HCR, le gouvernement du Burundi et les communautés locales afin d’offrir non seulement un accès à l’éducation, mais aussi la dignité, la protection et des opportunités pour les enfants rapatriés et leurs familles », a-t-il poursuivi. Avec cette inauguration, le projet « Rapatriement volontaire et réintégration durable des réfugiés burundais (2022-2024) » est officiellement clôturé. Au cours des 30 derniers mois, cette initiative a permis le rapatriement volontaire de plus de 50,000 réfugiés burundais dans la sécurité et la dignité, la fourniture de protection d’assistance complètes, le soutien aux moyens de subsistance résilients, et la réintégration scolaire de milliers d’enfants retournés. « Grâce à des formations, un soutien aux moyens de subsistance et des projets communautaires, le programme a renforcé la cohésion sociale et créé des voies pour une réintégration durable. Ces réalisations sont le fruit d’un partenariat solide entre KOICA, le HCR, le gouvernement du Burundi et les communautés locales » a conclu Nam Joohyun. Le HCR assure au Burundi la protection et l’assistance de plus de 110,000 réfugiés et demandeurs d’asile dans cinq camps de réfugiés, un site de réfugiés et des zones urbaines. Depuis, 2017, il a également accompagné près de 260,000 rapatriés burundais dans leur retour, dont 24,520 dans la commune de Gisuru. Pour plus d’information, contacter : Bernard Ntwari, ntwarib@unhcr.org; +257 79918902 Aline Irakarama, irakaram@unhcr.org; +257 71869340 Amina Bouarour,bouarour@unhcr.org; +257 71459459
1 / 5
Communiqué de presse
07 octobre 2025
Améliorons-nous ensemble : Bâtir les systèmes agroalimentaires de demain grâce aux quatre améliorations
Par M. Qu Dongyu, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture Cette année, la Journée mondiale de l’alimentation marque le quatre-vingtième anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui a dès le départ eu pour mandat de libérer l’humanité du besoin. À l’heure actuelle, environ 8,2 pour cent de la population souffre de sous-alimentation chronique, alors qu’en 1946, près des deux tiers de la population mondiale vivait dans des zones où l’accès aux denrées alimentaires était inadéquat, comme l’avait révélé la première Enquête mondiale sur l’alimenta3on menée par la FAO au cours de son premier mois d’existence. En outre, en 2025, bien que la population ait triplé, le monde produit largement assez de calories pour nourrir tous les habitants de la planète.Alors que nous célébrons cette journée, qui est l’occasion de réfléchir aux enjeux passés, présents et futurs, l’une des conclusions de cette étude réalisée il y a longtemps me revient à l’esprit : «Nous avons le choix entre aller de l’avant ou reculer.»La FAO et ses pays membres ont de nombreux accomplissements à leur actif : l’élimination du virus de la peste bovine, l’élabora3on des normes du Codex Alimentarius relatives à la sécurité sanitaire des aliments, la croissance des rendements mondiaux de riz, qui ont presque triplé depuis la création de la Commission interna3onale du riz à la fin des années 1940, la négocia3on de traités internationaux sur les pratiques de pêche et les ressources génétiques, la mise en place de dispositifs de suivi et d’alerte rapide afin d’atténuer les risques phytosanitaires et les risques liés aux maladies des végétaux et des animaux, la conception et l’hébergement du Système d’information sur les marchés agricoles afin de soutenir le commerce, et la formulation de recommandations alimentaires afin de lutter non seulement contre les problèmes de retard de croissance mais aussi contre la tendance croissante au surpoids dans le monde.Lorsque les invasions de criquets pèlerins ont commencé en 2019 – au même moment où la pandémie de covid-19 battait son plein – 231 millions d’USD ont été mobilisés pour atténuer la crise, ce qui a permis d’éviter des pertes es3mées à 1,77 milliard d’USD et d’approvisionner en nourriture plus de 40 millions de personnes dans 10 pays.Tout le mérite de ces réalisations revient à nos membres, qui n’ont cessé de soutenir l’idée selon laquelle un monde libéré de la faim est un monde meilleur pour tous, que l’on soit riche ou pauvre, que l’on vienne du Nord ou du Sud. Ces exemples, comme bien d’autres, montrent ce qu’il est possible d’accomplir lorsque les nations mettent en commun leur savoir et leurs ressources, qu’il existe une volonté politique et que des partenariats efficaces sont mis en place. Il est de plus en plus urgent de faire vivre l’esprit de coopération qui a prévalu au cours des 80 dernières années ; le système agroalimentaire mondial est plus interconnecté que jamais: plus d’un cinquième de toutes les calories franchissent des frontières internationales avant d’être consommées. En même temps, les menaces qui pèsent sur les systèmes agroalimentaires, telles que les chocs climatiques, les organismes nuisibles et les maladies, les ralentissements économiques ou les conséquences des conflits, ne connaissent pas de frontières et peuvent défaire des années de progrès dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Comme on peut le voir aujourd’hui avec la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, plus connu sous le nom de grippe aviaire, la chenille légionnaire d’automne et les invasions acridiennes, aucun pays ne peut combattre ce type de menaces transfrontières à lui seul.Nous devons faire en sorte que les personnes travaillant dans les systèmes agroalimentaires qui nous nourrissent, dont le nombre s’élève à plus d’un milliard, soient suffisamment résilientes pour faire face aux risques auxquels elles sont exposées en permanence.En plus de mécanismes financiers ayant fait leurs preuves, nous disposons des technologies, des cadres politiques, des connaissances et des capacités nécessaires pour atteindre rapidement l’objectif consistant à éliminer la faim. Il est essentiel de faciliter l’accès aux marchés si l’on veut réduire les inégalités qui nuisent à la résilience et acheminer les denrées alimentaires là où elles sont nécessaires. Pour assurer une véritable participation aux marchés, il faut promouvoir l’accès à des semences résistantes à la sécheresse, élaborer des normes de durabilité sur la pêche et les forêts, se mettre d’accord sur des normes phytosanitaires, développer les technologies numériques et mettre en place des outils novateurs de gestion des ressources et des systèmes d’alerte rapide.Nous avons mis en place un cadre afin d’intensifier et d’accélérer l’action menée. L’Initiative Main dans la main de la FAO permet de repérer les possibilités d’investissement et d’orienter les fonds en priorité vers les régions les plus touchées par la pauvreté et la faim et où le potentiel agricole est le plus important. Dans le cadre de son programmeUn pays, un produit prioritaire, la FAO s’emploie à promouvoir des produits agricoles nationaux présentant des caractéristiques uniques afin de favoriser la durabilité des systèmes agroalimentaires et la prospérité rurale. Le programme de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire, qui prend en compte le fait que de nombreux pays en développement sont devenus des acteurs majeurs du développement mondial et de la gouvernance économique, vise à encourager les investissements et les partenariats. L’objectif de l’initiativeVillages Numériques est de permettre aux agriculteurs du monde entier d’utiliser les technologies numériques et d’accéder plus facilement aux débouchés liés au commerce électronique, ainsi que de réduire la fracture numérique. Enfin, l’Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté du G20 regroupe des pays et des partenaires afin de mobiliser des moyens d’action et des investissements au service de l’élimination de la faim et de la réduction de la pauvreté au niveau mondial. Ces initiatives et bien d’autres instruments fonctionnent lorsqu’ils sont déployés de façon efficiente et efficace, et les résultats obtenus sont encore meilleurs quand les efforts sont menés avec constance et cohérence.À la FAO, cette vision est incarnée par les «quatre améliorations»: l’amélioration de la production, afin que les agriculteurs puissent produire plus avec moins de ressources; l’amélioration de la nutrition, car la qualité est aussi importante que la quantité; l’amélioration de l’environnement, afin de préserver la santé des écosystèmes et leurs multiples bienfaits, et l’amélioration des conditions de vie pour tous, afin que les populations rurales puissent vivre dignement et avoir accès à des possibilités. Prises ensemble, les quatre améliorations visent à garantir que personne ne soit laissé de côté.Si nous n’agissons pas pour les concrétiser, nous reviendrons en arrière. Quatre- vingts ans après la création de l’organisation, la faim n’a toujours pas été éliminée, mais ce n’est pas une fatalité. Guidés par une ambition commune, nous pouvons – et nous devons – aller de l’avant. Si nous poursuivons nos efforts de collaboration, nous pouvons mener à bien notre mission d’éliminer la faim et offrir à tous un avenir meilleur, où la sécurité alimentaire est assurée.
1 / 5
Communiqué de presse
05 septembre 2025
La Russie et le PAM apportent une aide alimentaire d’urgence aux familles touchées par les inondations et les sécheresses au Burundi
La contribution a été officiellement annoncée lors d’une cérémonie tenue aujourd’hui à Bujumbura, en présence de M. Jacques Kayange, représentant du Ministère burundais des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au développement ; de S.E. M. Valery Mikhaylov, Ambassadeur de la Fédération de Russie au Burundi ; et de M. Jean-Noël Gentile, Directeur pays du PAM au Burundi. « Cette généreuse contribution du Gouvernement de la Russie a été essentielle pour répondre aux besoins alimentaires des personnes vulnérables alors qu’elles se relèvent des impacts dévastateurs des chocs climatiques », a déclaré Jean-Noël Gentile, Directeur pays du PAM au Burundi. En étroite coordination avec les autorités locales et nationales, le PAM a distribué 1 500 tonnes de vivres, d’une valeur de 2 millions de dollars, composées de petits pois et de farine de blé. L’aide a ciblé 50 000 personnes vulnérables confrontées à l’insécurité alimentaire dans les provinces de Muyinga, Makamba et Rutana, durement touchées par les inondations et les sécheresses. Les distributions ont été réalisées avec succès en mai et juillet 2025. « Je suis honoré d’être présent à cette cérémonie. Il est symbolique que cet événement ait lieu en cette Journée internationale de la charité — une journée qui célèbre les actes de solidarité et de soutien envers autrui », a déclaré S.E. M. Valery Mikhaylov, Ambassadeur de la Fédération de Russie au Burundi. « Ce projet reflète notre engagement envers le peuple burundais. Nous avons confiance dans l’expertise du PAM pour faire en sorte que cette aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. » « Ce don est un geste de solidarité et de générosité qui nous touche particulièrement. Il symbolise le lien d'amitié et de coopération qui unit nos deux pays et nos deux nations. » a conclu M. Jacques Kayange. La Fédération de Russie est un partenaire solide du PAM au Burundi, ayant contribué à hauteur de plus de 4 millions de dollars depuis 2020 pour soutenir les efforts en matière d’aide alimentaire et nutritionnelle.################################The United Nations World Food Programme is the world’s largest humanitarian organization saving lives in emergencies and using food assistance to build a pathway to peace, stability and prosperity for people recovering from conflict, disasters and the impact of climate change.Follow us on X (formerly Twitter) via @WFP_AfricaFor more information please contact:Jean DE LESTRANGE, WFP/Bujumbura, Mob: +257 66 618924, jean.delestrange@wfp.org
1 / 5
Communiqué de presse
20 juin 2025
Message du Secrétaire général de l’ONU à l’occasion de la journée mondiale des réfugiés
Chaque personne réfugiée porte en elle l’histoire d’une perte insondable, d’une famille déracinée et d’un avenir bouleversé. Beaucoup se heurtent à des portes closes et font face à une montée de la xénophobie.Du Soudan à l’Ukraine, d’Haïti au Myanmar, un nombre record de personnes fuient pour sauver leur vie, alors même que l’aide s’amenuise.Ce sont les communautés d’accueil, souvent dans les pays en développement, qui supportent le plus lourd fardeau. Une telle situation est aussi injuste qu’intenable.Bien que le monde ne soit pas à la hauteur des circonstances, les réfugiés continuent de faire preuve d’un courage, d’une résilience et d’une détermination extraordinaires.Et lorsqu’on leur en donne la possibilité, ils apportent une contribution notable – en renforçant les économies, en enrichissant les cultures et en approfondissant les liens sociaux.En cette Journée mondiale des réfugiés, la solidarité doit aller au-delà des mots.Elle doit se traduire par un renforcement de l’aide humanitaire et de l’aide au développement, par l’élargissement de la protection et la fourniture de solutions durables telles que la réinstallation, et par le respect du droit de demander l’asile, qui est l’un des piliers du droit international. Elle passe également par l’écoute des réfugiés, qui doivent pouvoir s’exprimer sur la façon dont ils conçoivent leur avenir.Elle implique d’investir dans une intégration à long terme par l’éducation, le travail décent et l’égalité des droits.Devenir un réfugié n’est jamais un choix. Mais nous avons le choix de la réponse à apporter. Faisons donc le choix de la solidarité. Faisons le choix du courage. Faisons le choix de l’humanité. * * *
1 / 5
Communiqué de presse
08 mars 2025
Message du Secrétaire général de l’ONU à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, le 8 mars 2025
En cette Journée internationale des femmes, nous célébrons trente ans d’avancées et de progrès réalisés depuis la conférence historique des Nations Unies organisée à Beijing.Celle-ci a transformé les droits des femmes et permis de réaffirmer qu’ils étaient des droits humains.Depuis, les femmes et les filles ont renversé les barrières, brisé les stéréotypes et revendiqué la place qui leur revient.Mais nous devons être lucides sur les défis à relever.Bafoués ou restreints, les droits humains des femmes sont menacés.Des atrocités séculaires – la violence, la discrimination et les inégalités économiques – continuent d’accabler les sociétés.De nouvelles menaces, comme les algorithmes qui véhiculent les stéréotypes, créent des inégalités dans les espaces en ligne, ouvrant la voie à de nouvelles formes de harcèlement et d’abus.Au lieu d’observer une généralisation de l’égalité des droits, nous assistons à la banalisation de la misogynie.Nous devons combattre ces outrages.Et continuer d’œuvrer pour que les femmes et les filles disposent des mêmes chances que les hommes et les garçons.Nous devons agir pour débloquer des financements afin que les pays puissent investir dans l’égalité – et pour faire de ces investissements une priorité.Agir pour assurer l’égalité d’accès à des emplois décents, pour combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et pour résoudre les difficultés liées au travail domestique.Agir pour renforcer et appliquer les lois visant à mettre fin à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles.Agir pour garantir la pleine participation des femmes à la prise de décision, notamment dans le domaine de la consolidation de la paix.Et agir pour éliminer les barrières qui empêchent les femmes et les filles d’accéder aux filières des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.Le Pacte pour l’avenir et le Pacte numérique mondial donnent des orientations qui doivent guider ces actions.L’épanouissement des femmes et des filles profite à tout le monde.Ensemble, prenons des initiatives fortes pour faire de l’égalité une réalité pour toutes les femmes et toutes les filles, pour garantir leurs droits et pour leur donner des moyens d’action, dans l’intérêt général, partout.
1 / 5
Dernières ressources publiées
1 / 11
1 / 11